Il est question ici d’un livre que je n’ai pas lu – mea culpa ! – dont le moins qu’on puisse dire est qu’il est controversé, en plus d’avoir fourni au jeanmarie l’occasion d’un de ses plus célèbres calembours de bon goût. Il n’y est pas question, en revanche, d’un autre livre, suscité par le premier, que – mea culpa – je n’ai pas lu non plus. Pour combler cette lacune, il m’a semblé que le mieux était de vous les présenter tous les deux (juste après cet article). Théroigne.
L’angoisse de Céline se fait style
Pierluigi Pellini – il manifesto – 26.4.2020
Traduction : Les Grosses Orchades
Gen Paul – Montmartre, Paris
Classiques du XXe siècle. Le réprouvé reparaît en librairie en 1952 avec Féerie pour une autre fois. C’est un fiasco. Et la raison pour laquelle Gallimard changera en Normance le titre du second volume. Aujourd’hui, voilà qu’en Italie aussi, les deux volumes sont réunis. Par Einaudi.
S’il est vrai que l’objectif invoqué – et probablement, du moins en partie, sincèrement poursuivi – par les pamphlets racistes de Céline et par son militantisme collaborationniste fut celui, noblement pacifiste, d’éviter à tout prix un nouveau carnage (« je voulais empêcher le massacre ! ») des simples soldats, orchestré par les pouvoirs économiques et politiques, identifiés par les légendes noires du nationalisme le plus cru à la finance hébraïque, et s’il est vrai que 1915 avec ses massacres et 1917 avec ses fusillés pour l’exemple reviennent de façon obsessionnelle jusqu’à dans ses romans de la IIe Guerre mondiale, il est vrai aussi que l’abjection sans limites de l’homme Céline ne peut plus être mise en doute après le réquisitoire d’Annick Duraffour et Pierre-André Taguieff : Céline, la race, le Juif. Légende littéraire et vérité historique (Fayard, Paris 2017):, gros pavé assez déplaisant à lire pour son indifférence ostentatoire à la qualité esthétique et à la complexité du verbe littéraire, mais entreprise probatoire hyper-documentée et glaçante. Bref, il serait temps, en Italie aussi, de ne plus prendre pour argent comptant des biographies dépassées, vaguement apologétiques, telles que celle de François Gibault (1985)
Le parti de la vie
N’en sont pas moins illimitées, et fraternelles aux yeux de qui n’est pas aveuglé par le militantisme idéologique, la souffrance, la peur, la révolte vengeresse d’un anarchiste qui a reconnu, dans toute forme de contrôle social (des commérages médisants du parisianisme aux lourdeurs de la bureaucratie soviétique), dans toute hiérarchie de valeurs culturelles (surtout si elles sont officielles), l’ordre homicide d’une machine de guerre, l’alignement féroce d’un peloton d’exécution, et n’attribue les caractéristiques de la vérité humaine qu’aux seules exigences primaires du corps nu, à un vitalisme élémentaire et incoercible (« Je suis du parti de la vie, voilà !).
.C’est justement dans ces trois fameux pamphlets que Céline élabore ce style syncopé, ce rythme agité et interjectif, cette accumulation d’imprécations hurlées et illogiques, qui dominera dans les romans du second après-guerre, transformant la page écrite en une explosion mosaïque de figurations expressionnistes et de délirants « j’accuse ».. C’est pourquoi les gardiens du politiquement correct à la française ont commis une erreur en interdisant au-delà des Alpes la réimpression de Bagatelles pour un massacre, dont le magma confus de fiel et de préjugés (non sans raison suspect aux yeux des hiérarques nazis les plus avertis) s’impose immédiatement pour ce qu’il est : une blessure incurable, une lacération de soi affreusement sublimée en un terrible bonheur d’expression.
Autobiographie d’après-guerre
C’est à la même rhétorique ostentatoirement non-démonstrative, à la même prose interjective scandée par l’aphasie des points de suspension que recourt Céline dans les deux premiers romans autobiographiques écrits après la guerre, Féerie pour uen autre fois I et II, le premier se déroulant pendant les quelques jours qui ont précédé sa fuite de France et ensuite, dans sa prison danoise, le second, mimesis d’une virtuosité folle et en même temps recréation expressionniste et amplification onirique d’un bombardement allié sur Paris : plus de 350 pages pour une seule nuit.
Tous les deux dénonciation, du point de vue de la victime, d’un complot ourdi contre « le seul écrivain français qui se soit retrouvé au gnouf pendant ces années sinistres » (comme si quatorze mois derrière des barreaux danois avaient été pires que l’exécution d’un Brasillach fusillé ou le suicide choisi par un Drieu la Rochelle), et revendication d’une assez douteuse innocence de Céline médecin des pauvres au service des humbles et des animaux (« j’aime Bébert », le chat, « j’aime mes malades »), corps étranger dans les salons collaborationnistes, pro-allemand par calcul pacifiste et maintenant bouc-émissaire de l’hypocrisie engagée*. Tous les deux tourbillonnant mélange de chronique et de mémoire, dans une systématique « confusion des lieux, des temps ! ». tous les deux déchirés par une angoisse existentielle aussitôt traduite en style qui dépasse les contingences judiciaires, pour devenir somme de l’histoire célinienne. « Jamais, jamais j’ai pu attendre ! » Parce qu’attendre est le privilège des riches.
La cible la plus fréquente des invectives les plus colorées de Céline, on ne la trouve pourtant pas chez les divers intellectuels de la gauche*, « le pantin Narte et la belle Elsa » (Triolet, qui, dans une page de coprolalie visionnaire, urine sur le je narrateur) mais bien chez Jules, le peintre et sculpteur alcoolique, homme de droite, mutilé de la Grande guerre, double fictionnel de Gen Paul, jadis ami très intime de Céline, et ce n’est pas à cause de l’éloignement idéologique survenu ni des désaccords personnels
Oui, Jules est le collabo prudent qui, après Stalingrad, jette par-dessus bord l’écrivain en le traitant de boche et qui, pour faire bonne mesure, assaille sa femme, dans un accès de lubricité dégoûtante, toléré de façon ambiguë par Lili et obsessionnellement ressassé par la jalousie paranoïaque du narrateur. Si l’abstinent Céline se présente comme « l’homme des mystiques qui ne paient pas », Gen Paul est, à l’opposé, l’opportuniste qui, à la Libération, échappera à toutes les purges – lui qui avait été le commensal et convive de l’ambassadeur allemand Otto Abetz, dans Paris occupé. Mais il est aussi le peintre de Montmartre qui incarne une idée de l’art à la fois populaire et expressionniste.
Le cauchemar qui bouleverse l’univers narratif de Céline, transformant sa cellule danoise en caisse de résonance du trauma ou le bombardement allié en luciférienne exhibition pyrotechnique – presque tableau d’un Chagall « noir » qui, dans le ciel de Paris, mêle au vol des bombardiuers la dégringolade des immeubles détruits – transpose en langage une tension créatrice analogue, brossant et modelant une image de désastre (« c’était plus terrible que ses détrempes »), qui marie les décombres de la guerre à l’intériorité du survivant coupable, victime du sadisme grégaire et du voyeurisme macabre des vainqueurs..
Allusions perdues
Un gros volume vient de sortir dans l’élégante collection « Lectures Einaudi », (Pantomime pour une autre fois. Normance, traduction de Giuseppe Guglielmi, bel essai-préface de Massimo Raffaeli, XII–580 pp, 26 €), qui réunit en fin de compte, lui aussi, en italien, les deux livres jumeaux. Mais il ne restitue pas au second le titre choisi par l’auteur pour établir l’unité du distique : Féerie pour une autre fois II. Le retour du réprouvé dans les librairies françaises avec la première Féerie, en 1952, avait été un fiasco, malgré la prestigieuse caution du sigle Gallimard ; c’est justement l’éditeur qui, deux années plus tard, avait débaptisé Féerie II pour le rebaptiser Normance, du nom d’un second rôle obtus, pachydermique, somnolent et néanmoins bestialement agressif, pour marquer une distance entre les deux livres, à des fins purement commerciales.
La reconstructiondu plus grand spécialiste en philologie célinienne, Henri Godard, ne laisse aucune place au doute ; il est donc peu compréhensible qu’Einaudi ait choiside conserver le faux titre. Et aussi de renoncer à toute forme d’appareil critique, aux quelques notes au moins qui eussent été indispensables à la compréhension minimale de la lettre de deux romans qui regorgent d’allusions à un présent devenu lointain, à unehistoire oubliée des Français eux-mêmes, à une biographie encore obscure à bien des égards.
On éprouve un peu moins d’étonnement mais davantage encore de perplexité à voir qu’Einaudi se soit contenté de reproduire, pour les deux textes, sans la moindre correction, la traduction du poète Guglielmi, qui remonte aux années 80 du siècle dernier, et s’avère idiosyncratique, sinon trompeuse, dès le frontispice, où le mot Pantomime fait virer au comique et au théâtral l’ambivalence du mot Féerie : fantasmagorie, à mi-chemin entre enchantement lyrique et fabuleux ; déformation grotesque (curieusement, à l’intérieur du texte, Guglielmi est forcé de rendre presque toujours « féerie », précisément par « fantasmagorie »). Mais il s’agit d’une traduction devenue mythique, souvent promue au rang de modèle inégalable, par les spécialistes les plus aguerris ès théorie de la traduction (la soi-disant « traductologie », assurément plus admirée en tant que concept que concrètement lue)..
Dans l’habitus traductif de Guglielmi – qui, avec la même instrumentalisation théorico-linguistique, a ré-écrit (plus que traduit) la soi-disant Trilogie du Nord (toujours chez Einaudi) et Mort à crédit (resté dans les tiroirs pour des raisons liées aux droits d’auteur) – convergent la suggestion d’un trop célèbre essai de Walter Benjamin, sur Le devoir du traducteur, où il proclame hautement son mépris avant-gardiste pour les exigences du lecteur (« Jamais, face à une œuvre d’art ou une forme artistique, le respect envers qui la reçoit ne s’avère fécond pour la connaître »), et semble autoriser la démarque au nom d’une fidélité extrémiste « interlinéaire » à la partition linguistique de l’original et le parti-pris d’un poète proche du gruppo 63, pour qui l’effet rythmique prime sur le sens, où la réussite sonore d’une phrase isolée compte plus que le fil de la narration (pourtant revendiqué dans l’original : « Il y a un fil continu, je jure ! », et en fin de compte, l’autonomie du signifiant nie tout droit au signifié et à la logique du récit.
La syntaxe narrative du Céline des derniers temps est à la fois fragmentée et redondante, mais ne renonce pas à une mimesis bouleversée : sa langue est surchargée, agglutinée, elle dépasse les bornes, mais n’est pourtant jamais intransitive – elle veut être au contraire « transposition immédiate, spontanée » d’un monologue intime, comme l’explique sa lettre célèbre à Milton Hindus, du 15 mai 1947. L’écrivain sait bien que l’effet de langue parlée naît d’un artifice verbal complexe, raffiné, qui doit toutefois demeurer invisible, visant à donner une impression d’authenticité orale, d’immédiateté violente. C’est le fameux « rendu émotif », la célébrissime « petite musique », archi-personnelle et néanmoins communicative. Guglielmi s’invente, au lieu de cela, une langue intransitive et inexistante, qui, pour conserver de quelque manière la cadence rythmique de l’original, accumule les décalques syntaxiques et les infidélités lexicales, au point de rendre beaucoup de pages presque (ou tout à fait) incompréhensibles.
Féerie II, par exemple, se déroule en grande partie dans la loge* de la concierge, au rez-de-chaussée de l’immeuble où habite Céline, à Montmartre. En Italien, la loge se transforme en « loggia », qui se trouve occupée par une « bidelle » [femme de charge dans une école, NdT], puisque Céline dit bignolle*, qui veut dire « concierge » en argot, le traducteur sacrifiant le sens au plaisir d’une vague consonance. Jules est affalé dans une gondole*, terme qui, en français peut désigner aussi bien une embarcation qu’un fauteuil, et qui indique ici un siège pour invalide, mais, pour Guglielmi, et à répétitions, c’est « gondola ».
On pourrait multiplier les exemples. Mais plus encore que les altérations du sens, ce sont les chambardements casse-tête de la syntaxe : à commencer par la postposition systématique de la préposition négative « ne » [« lui ha no il delirio », « È no da ieri che ci si conosce », « Hai no conosciuto l’Antico», « Rendi no il mezzo servizio ? »] et ainsi de suite, page après page, pour singer l’absence de « ne » français dans la locution adverbiale « ne pas » (et comme mettre en avant l’adverbe négatif paraissait indigne à Guglielmi, si, dans son texte, on lit « sta più vicino alla moglie »,, il faut comprendre « non sta più… »; ainsi, « è più che un coagulo la sua testa » veut naturellement dire « non è altro che un coagulo »). Mais ne sont pas moins gênants et inutiles le prétentieux « solo che », quelquefois employé pour signifier rien que, mais quelquefois aussi par simple goût de la distorsion : « niente risposte evasive ! solo che il categorico ! », et ainsi de suite…
Le lecteur qui se limiterait à picorer l’un ou l’autre passage en ouvrant le livre au hasard pourrait bien, ici ou là, faire une trouvaille heureuse : ainsi, par exemple, Normance, commerçant malhonnête en temps de guerre, désigné en français par l’italianisme mercanti (au singulier), devient « borsaro nero » [personne qui fait du marché noir, NdT]. Peut-être y trouverait-il matière à perpétuer le mythe de Guglielmi traducteur d’avant-garde, mais peut-être se dirait-il que Céline écrivait en petit-nègre* : « quindici giorni faceste niente cacca abbaiereste no voi ? ». Quiconque, cependant, voudrait lire le livre d’un seul trait éprouverait (pour le dire dans la langue de Guglielmi) seulement qu’un sentiment de frustration exaspérée.
______________________
*en français dans le texte
Source : https://ilmanifesto.it/lansia-di-celine-si-fa-stile/
Source d’origine : https://pierluigipiccini.it/lansia-di-celine-si-fa-stile/
Traduction : c.l. pour Les Grosses Orchades
Annick Duraffour et Pierre-André Taguieff
Céline, la race, le Juif
Fayard, 2017
1182 pages
35 €
Présentation de l’éditeur :
Tout lecteur de Céline se trouve placé devant l’alternative : faut-il prendre au sérieux ou non l’antisémitisme de l’écrivain-pamphlétaire, et de quelle manière ? Que sait-on de ses activités collaborationnistes ? Les auteurs font l’étude complète du « cas Céline », croisant et confrontant les apports des historiens et des « littéraires », pour une approche renouvelée du grand écrivain.
David Alliot et Eric Mazet
Avez-vous lu Céline ?
PG DE ROUX
128 pages
10,40 €
Présentation de l’éditeur :
Rarement un homme de lettres aura déchaîné autant de passions que Louis-Ferdinand Céline. Écrivain de génie, mais pamphlétaire antisémite, son attitude pendant l’Occupation ne cesse d’interroger. En 2017, deux « historiens » ont publié un livre à charge prétendant faire la lumière sur la face sombre de Céline, où celui-ci est dépeint, entre autres, comme un hideux dénonciateur, et un agent de l’Allemagne. Au point qu’on se sent en droit de leur demander : « Avez-vous lu Céline ? » Avec précision et rigueur, David Alliot et Éric Mazet répondent aux accusations de ces deux « scientifiques », mettent à mal leurs affabulations et apportent leur propre éclairage sur cette période mal connue de la vie de Céline. Ils reviennent également sur le projet des éditions Gallimard de rééditer les pamphlets antisémites de l’écrivain et expliquent pourquoi, assez paradoxalement, il est indispensable et nécessaire de le mener à terme.
Aparté
Traduttore, traditore !
Théroigne – 11.11.2020
Il est difficile, à qui n’entend pas l’italien, de comprendre d’après ma traduction, la frustration et l’irritation ressenties par Pierluigi Pellini, grâce à qui nous découvrons quand même qu’il se trouve, ailleurs qu’en francophonie, des gens pour traduire en « petit-nègre », c’est-à-dire en charabia. Et de le mal faire aussi, quelquefois, par présomption.
La maltraitance des langues n’a rien à voir avec Céline, mais peut-être un peu quand même avec le structuralisme. (Tiens, qu’est-ce qu’ils deviennent, ceux-là ?). La torture sadique de la nôtre atteint aujourd’hui des sommets avec l’écriture dite « inclusive ». Enfoncés, Guglielmi et son avant-gardisme ! À tous les coups, on le bat.
Il ne faudrait pas se donner grand mal pour lui trouver des homologues en français. J’ai déjà évoqué le livre de mon compatriote émigré Luc Sante, devenu auteur US, dont le titre The factory of facts (La fabrique des faits) est devenu, par la grâce d’Actes Sud L’effet des faits, ce qui veut dire exactement le contraire. Qu’importe que Sante ait voulu, dans son titre, rendre hommage à sa ville natale, où les usines textiles s’appelaient des fabriques – celle dont son père fut éjecté à la fin des années 50 le forçant, justement, à émigrer outre-Atlantique… Qu’importe qu’il ait voulu, nous faire comprendre que cette expulsion avait littéralement fabriqué sa vie… Et qu’importe qu’il ait aussi, en passant, voulu rendre hommage à Dziga Vertov, qu’il admire, du moment que le traducteur a pu se faire plaisir avec son assonance-allitération privée de sens.
Les exemples de ce genre sont multiples, parce que la présomption dcs cuistres se porte aussi bien ici qu’ailleurs. On l’a vu, au niveau des titres, avec le Sans issue de Manckiewicz transformé en La porte s’ouvre et Le ciel au-dessus de Berlin de Wenders devenu Les ailes du désir, évidemment plus vendables chez les ploucs ;
Une anecdote en passant, parce qu’il s’agit d’un livre italien traduit en français :
Andrea Camilleri a deux traducteurs : Serge Quadruppani qui a su miraculeusement reproduire dans notre langue le vigatais inventé par le père de Montalbano, et Dominique Vittoz, très honorable traducteur de ses livres écrits en italien « normal ». C’est notamment lui qui a traduit La couleur du soleil, dans lequel l’auteur raconte comment un délinquant, avant de finir cramé dans une voiture par la mafia, lui a fait parvenir un coffret contenant diverses choses plus ou moins précieuses, dont une lettre manuscrite inconnue du Caravage. « What a yarn ! » se serait écrié avec admiration l’éditeur Sproule (faites pas attention…).
Bien entendu, Camilleri s’est donné du mal pour que la mystérieuse lettre ait l’air authentique, autrement dit, il l’a rédigée en faux italien du XVIIe. On appelle ça un pastiche. (Il faut voir comment, en français, M. Frédéric Lenormand fait parler son Voltaire, son Corneille ou son Molière, voire son juge Ti à la manière de Van Gülik). M. Vittoz, hélas, a dû prendre le Caravage pour un Catarella d’époque et tenter de reproduire son baragoin. Le résultat est hallucinant. Pas un mot sur cinq n’est du français, de l’italien ou quoi que ce soit. Bref, ce n’est même plus du « petit-nègre » ni du charabia, c’est de l’écolier limousin ! Alors qu’il eût suffi d’un honnête pastiche de français du Grand siècle ou du français correct d’aujourd’hui (orthographe inclusive exclue). Le mieux est l’ennemi du bien.
Mais je ne voudrais pas que vous pensiez que je ne sais rien faire qu’à critiquer… c’était juste pour dire que le sujet est vaste.
URL de cet article : http://blog.lesgrossesorchadeslesamplesthalameges.fr/index.php/langoisse-de-celine-se-fait-style/
9-11 novembre 2020


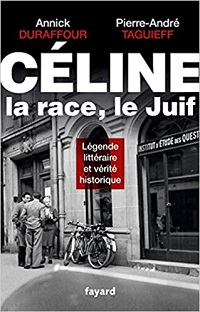
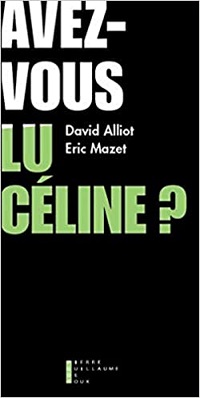
0 Comments