Stanislawa et la Révolution
Les œuvres en polonais de Stanislawa, nous l’avons dit, se trouvent dans les archives de l’Académie polonaise des sciences à Poznań.
On ne trouve (trouvait ?) en français qu’une traduction de L’affaire Danton, publiée en 1982 par Vladimir Dimitrijevic :
Stanislawa Przybyszewska
L’Affaire Danton
Lausanne, L’Age d’Homme – 1982
Collection : Les classiques slaves
204 pages
Si on veut découvrir Przybyszewska aujourd’hui, il faut la lire en anglais :
Stanislawa Przybyszewska
The Danton Case & Thermidor : Two Plays
Evanston, Illinois – Northwestern University Press – 1989
298 pages
Jadwiga Kosicka et Daniel Gerould
A life of Solitude : Stanislawa Przybyszewska, a Biographical Study with Selected Letters
London – Quartet Books Ltd – 1987
Evanston, Illinois – Northwestern University Press – 1989
247 pages
Quatrième de couverture :
A Life of Solitude est une biographie de la dramaturge polonaise Stanislawa Przybyszewska (1901-1935). L’une des plus belles pièces sur la Révolution française, L’Affaire Danton, a été écrite par cette Polonaise inconnue, qui vivait dans l’obscurité dans la ville libre de Danzig. Fille illégitime de l’écrivain Stanislaw Przybyszewski, elle est devenue écrivain contre toute attente et au prix de sa santé, de sa raison et finalement de sa vie. Une vie de solitude montre comment elle a choisi sa vocation, examine ses idées sur l’écriture et raconte sa lutte contre les conditions matérielles de son existence. Tragiquement, elle en est venue à substituer la créativité à la vie et s’est accrochée à sa vocation avec une obstination qui a émoussé son instinct de conservation et l’a conduite à mourir de morphine et de malnutrition à l’âge de trente-quatre ans.
Deux critiques éditoriales
La première, du Publishers Weekly
« Il est difficile d’imaginer un public pour ces lettres grincheuses, si obsessionnelles que leurs destinataires les ont probablement jetées sans y réfléchir. Selon Kosicka, traductrice, et Gerould, mari de Kosicka et professeur de théâtre à la City University de New York, Przybyszewska (1901-1935), fille illégitime d’un célèbre écrivain polonais, mérite l’attention pour le génie dont elle fait preuve dans sa pièce sur la Révolution française, Le cas Danton. Mais comme cette œuvre attend d’être publiée et mise en scène en anglais, les vicissitudes de la carrière littéraire de la Polonaise Przybyszewska – le principal sujet de ses épîtres – restent méconnues. Déterminée à être « écrivain à 100% », elle s’est isolée à l’âge de 24 ans, emménageant dans un minuscule appartement mal chauffé qu’elle quittait rarement, écrivant huit à neuf heures par nuit et dormant le jour, et maintenant le contact avec les autres presque exclusivement par correspondance (correspondance dont elle gardait des copies). Une dépendance à la morphine ne fit qu’accentuer ses particularités et sa suffisance immodérée. Illustrations non vues par PW. ». Copyright 1989 Reed Business Information, Inc.
La seconde, du Times Literary Supplement
« A Life of Solitude relate une histoire unique d’ambition humaine et d’effondrement ».
Il est évident que, même en anglais, cet écrivain n’a dû sa partielle et tardive publication qu’au bruit fait autour du film de Wajda.
Vous avez dit « écrivain maudit » ? Maudite dans sa vie et maudite aussi après sa mort, la pauvre Stanislawa.
Car… [Parenthèse] le film de Wajda tiré de sa pièce en prenait le contrepied absolu et lui faisait dire tout le contraire de ce qu’elle avait dit ! Prétendument pour dénoncer la « situation en Pologne » dans les années 1980. C’était l’époque, voyez-vous, ou l’affreux Jaruzelski essuyait les plâtres en prévision de l’arrivée de l’abominable Poutine. Sans compter qu’on s’approchait d’un Bicentenaire qu’il allait s’agir de désamorcer, si possible « préemptivement », comme on dit chez les Bush. Sinon, à quoi eût rimé de faire tenir à Robespierre, au cinéma, le rôle joué dans la réalité par Danton ? Pourquoi remplacer un traître homologué par un qui n’avait rien fait, si ce n’était par vice ou parce qu’on était payé – probablement assez bien – pour le faire ? Bref, Lech Walesa, Wajda, Wojtyla = même combat et mêmes maîtres. Et qu’importe s’il fallait pour y réussir, piétiner quelque peu une bonne femme que personne ne connaissait de toute façon ? Mis à part Serge Merlin, qui avait des circonstances atténuantes, aucun de ceux qui se sont commis dans cette action crapuleuse n’est excusable. Surtout les Français ! Depardieu au premier chef, mais aussi Planchon (Planchon !). Passons. C’est de Stanislawa qu’on parle.
Naître femme, bâtarde et pauvre, dans un pays de l’est de l’Europe, au tout début du XXe siècle, pour se trouver presque aussitôt précipitée dans la Première guerre mondiale, dans la Révolution russe et bientôt le nazisme, n’aurait en aucune façon pu être une partie de plaisir. Mais avoir pour géniteurs deux des êtres les plus profondément irresponsables qui aient jamais fait un enfant ensemble, vous a quand même des airs de malignité sadique de la part des dieux.
Pour comble de malheur, Stanislawa était dotée d’une intelligence assez supérieure à la moyenne, qui ne pouvait lui permettre de vivre son sort comme le font les bêtes de somme : être malheureuse comme les pierres et l’être injustement n’est pas si rare, mais savoir exactement pourquoi et comment relève de la torture exquise.
Ajoutons que le don des langues – elle en parlait couramment quatre – ne pouvait qu’aiguiser davantage son besoin de communiquer avec des cerveaux semblables au sien ou du moins avec des « gens éduqués », ce qui est, bien sûr, rigoureusement impossible quand votre place dans la société vous interdit de même les approcher et les rend, eux, incapables de même savoir que vous existez.
Je regrette profondément (c’est c.l. qui parle) n’avoir pas eu le temps, pour aujourd’hui, de traduire l’excellente mais longue préface de Daniel Gerould à The Danton Case & Thermidor. Stanislawa est loin d’y justifier le croquis sans nuance ni empathie du critique de Publisher’s Weekly. Gerould, lui, semble avoir vraiment compris l’implacable enchaînement de tous ses malheurs, le fatum qui toujours l’a ré-enfoncée plus profondément, à chaque fois qu’elle a essayé, sa vie durant, de sortir la tête de l’eau. De l’eau ? Non, de la vase ! Du pus. De la sanie.
Mais les quelques brins de citations de ses lettres à Thomas Mann citées plus haut font comprendre l’indifférence agacée du critique. Il est évident qu’elle avait une haute opinion d’elle-même, héritée ou imitée de son père, et peut-être plus légitime. Il est évident aussi qu’à ce stade, son cerveau était trop enserré dans les rets de la drogue pour qu’elle pût encore maîtriser quoi que ce soit. Quelle qu’elle ait pu être auparavant son intelligence, elle n’était plus, alors, en état de rien contrôler : ni ce qu’elle pensait, ni ce qu’elle écrivait, ni ce qu’elle faisait. Les descentes aux enfers de surdoués sont toujours laides à voir. Et n’éveillent que rarement la sympathie, ou même simplement la compréhension de ceux qui, pour leur bonheur, ne sont pas eux-mêmes des surdoués maudits.
Il semble cependant que Stanislawa ait trouvé, en sa compatriote (émigrée ?) Jadwiga Kosicka et dans le mari américain de celle-ci, Daniel Gerould, des traducteurs dotés d’atomes crochus. Finalement, les affinités électives ne sont pas toujours de vains mots.
Faut-il dire qu’il serait souhaitable qu’au moins ses pièces sur la Révolution soient enfin traduites en français ? Ne fût-ce que parce qu’on y trouve quelque chose qu’on ne trouve pas ailleurs avant elle.
On a vu que son intérêt pour la Révolution remontait à son adolescence, voire à son enfance, par tous les signes qu’elle en avait vus en visitant les musées parisiens avec sa mère.
Sa collision frontale suivante lui vint de Büchner et de La mort de Danton, qu’elle avoue avoir lu onze fois, avant de s’attaquer elle-même à un tel sujet. Quand il a écrit cette pièce, Büchner était un très jeune homme, avec, pour ainsi dire, le nez encore sur les événements qu’il traitait et persuadé de l’absolue vérité de ce qu’on appellerait aujourd’hui en pidgin la « narrative » officielle. Un jeune homme tombé la tête la première dans un romantisme en pleine irrésistible ascension et qui allait mourir à 23 ans.
Son Danton n’a rien à voir avec le vrai Danton, comme c’est souvent le cas avec les mises en scène ou en roman de personnages historiques, mais celui qui l’a fantasmé a exercé une forte influence sur la jeune femme qui, un siècle plus tard (ils sont morts à presque cent ans juste de distance) allait l’imiter en portant, elle, le double fardeau de leurs deux époques.
C’est donc après avoir lu onze fois la pièce allemande qu’elle s’est lancée dans la sienne. Dont il y a eu quatre versions. Car, en cours de route, elle avait, à Paris, rencontré Albert Mathiez et ils avaient – l’historien et la jeune fille – échangé leurs idées, leurs sentiments et leurs opinions – échanges qui l’avaient persuadée, elle, que son interlocuteur, on pourrait presque dire son mentor, était absolument dans le vrai. C’est donc dans une optique très différente qu’elle a recommencé sa pièce, à plus d’une reprise. Dans cette métamorphose de Büchner en Mathiez, elle n’a jamais pu, cependant, tout supprimer de son « premier Danton », c’est-à-dire jamais le considérer en toute objectivité. Et il est bien connu qu’un créateur ne peut jamais mépriser ni détester sa créature, sous peine d’accoucher d’un monstre sans consistance réelle.
Il ne faut donc pas chercher, dans L’affaire Danton, même post-Mathiez, le vrai Danton. Ni, dans Thermidor, le vrai Robespierre. Non plus d’ailleurs que le vrai Barère ni le vrai Fouché, ni aucun des autres.
Entendons-nous bien : quand quelqu’un écrit ou parle de Robespierre, il est rare qu’on en apprenne quelque chose d’intéressant sur l’Incorruptible et presque jamais la vérité, mais il arrive presque toujours qu’on en apprenne beaucoup sur celui qui en parle. Robespierre n’est pas seulement le plus extraordinaire des paillassons à fantasmes, il est aussi quelque chose comme une pierre de touche : un révélateur. Dans le cas d’un auteur dramatique tel que Stanislawa, jeune et enfoncée jusqu’aux yeux dans le chaudron de sorcières qu’a été l’Europe des débuts du XXe siècle, il était impossible que ce qu’elle créait rende un compte exact de gens et d’événements qui avaient appartenu à un autre siècle, à un autre monde. Le continent venait de traverser des choses qui n’étaient même pas pensables du temps de ses révolutionnaires de France.
La Révolution Française a été faite, à une ou deux exceptions près, par des gens très jeunes. Quand Przybyszewska est arrivée à l’âge que Saint-Just avait au moment de quitter Blérancourt, tout le continent sortait d’un bain de sang qui avait anéanti une génération presque entière de jeunes hommes. La mode – si on peut parler de mode en ces matières – du lesbianisme n’a pas eu d’autre origine. Les déviances intellectuelles, morales, artistiques et autres, dont son propre père a été une des plus complètes illustrations, en ont découlé comme l’œuf de la poule ou la poule de l’œuf. Comment aurait-elle pu envisager ce morceau d’histoire avec la calme objectivité d’un Vladimir Poutine bien dans sa peau, étudiant les données d’une situation géopolitique d’aujourd’hui ?
Il y a donc, dans son oeuvre, de la subjectivité – ô combien – mais on y trouve aussi la préoccupation nouvelle qu’elle revendiquait.
Gerould :
« Przybyszewska a déploré que les souverains de l’Antiquité, tels qu’ils sont dépeints par Shakespeare, n’aient pas d’ambitions au-delà de la sphère personnelle et semblent dépourvus de toute conception de la créativité sociale. Sa propre croyance en des individus exceptionnels capables de sacrifier leur vie privée au nom d’une cause supérieure s’inspire de Bernard Shaw, dont César et Cléopâtre et Sainte Jeanne offrent des exemples de protagonistes héroïques. Pleine d’enthousiasme pour Retour à Mathusalem, Przybyszewska partageait la foi de Shaw dans le développement accéléré d’esprits humains supérieurs, progressivement libérés du poids de la matière. »
Et il est bien vrai qu’une quelconque aspiration à un quelconque « bonheur commun » ne semble avoir préoccupé aucun des personnages de Shakespeare, surtout ceux appartenant aux classes dominantes. À peine voit-on poindre, et encore d’assez loin, dans le célèbre monologue d’Henry V (« Once more unto the breach, dear friends ! »), ce qui allait trouver son expression la plus héroïque dans Alexandre Nevski (quatre ans après la mort de Stanislawa !) et dans Ivan le Terrible encore plus tard.
On sait qu’elle est morte sans avoir pu achever Thermidor, dont il manque le dernier acte. On le regrette pour ce qu’elle avait encore à dire sur elle et sur nous, pas pour ce qu’on perd d’information historique ou psychologique sur les personnages.
Gerould encore :
En partie façonné à son image, en partie conçu d’après un modèle shavien, Robespierre, dans L’Affaire Danton et dans Thermidor, est un génie transsexuel suprapersonnel qui s’efforce de se mouvoir dans le domaine de la pensée pure tout en s’attaquant aux problèmes de la réalité sociale et de la nature humaine. Sa dévotion absolue à la raison et son refus du compromis provoquent son aliénation du monde qui l’entoure et le conduisent pas à pas à sa chute tragique.
Et ça, ce n’est pas Maximilien, c’est Stanislawa. Ce qui est démontré de façon frappante par deux photos, prises alors qu’elle luttait contre le froid, la faim et la drogue, dans sa quasi cellule de deux mètres sur trois, vers 1930 :
Il suffit de comparer ces photos à celles qui les précèdent pour comprendre – et ne pas juger – la trajectoire de cette brillante et malheureuse jeune femme, et pour comprendre aussi, au moins un peu, l’évolution de ses idées.
Teatr Polski « THERMIDOR » reż. Edward Wojtaszek
Les lunettes trop petites et les gants trop rouges ne plaident pas en faveur d’un excès d’originalité.
Ceci s’appelle, en peinture, un repentir…
Przybyszewska dans les dernières années de sa vie a fait Robespierre à son image ou comme elle avait besoin qu’il fût. Et Henri Guillemin, dans les dernières années de sa vie, a fait exactement la même chose. Autant il avait fait œuvre d’historien dans sa vision du rôle politique de Maximilien, autant il a, lui-même, détruit une partie de son travail et l’intégrité d’un grand homme, avec son Robespierre, politique et mystique de 1987.
Robespierre ne pouvait pas être mystique, parce que la politique et le mysticisme s’excluent mutuellement. Vouloir les accoupler, c’est ignorer l’un autant que l’autre.
Un mystique, c’est quelqu’un qui est, toujours, partout et en tout, seul avec son dieu. Pour qui son dieu est tout, à l’exclusion de quoi que ce soit d’autre. Comme le blanc et le jaune d’un œuf à l’intérieur d’une coquille. Pas de place pour rien d’autre, pas même pour un peu d’air. Un politique c’est quelqu’un qui n’existe, surtout s’il est grand, qu’en fonction des autres, souvent à l’exclusion de lui-même (« Lettre de Maximilien Robespierre à ses commettants, j’entends par là tous les Français » ).
Le fils de François Robespierre pouvait difficilement avoir un dieu, comme tous ceux dont le destin est d’être divinisé un jour.
Je m’explique avant qu’on m’enferme : tous les mythes – c’est-à-dire tous les dieux – ont, si peu et si loin que ce soit, une origine réelle, historique. A contrario, il arrive qu’un mythe éteint depuis des âges et ne disant plus rien à personne, se réactualise en fait historique. Le schéma suivi par cette réactualisation permet à ceux qui sont un peu observateurs d’identifier le mythe. Ce n’est pas aussi rare qu’on le pense. Ce sont ceux qui s’en aperçoivent qui sont rares.
Quand on a un peu fréquenté ces choses, on est frappé, dans le cas de Robespierre, par la métamorphose du parcours humain d’un avocat provincial (traité même de petit-bourgeois par M. Malaparte) en répétition du mythe d’Héraclès, pas à pas, jusque dans les détails apparemment anecdotiques. On peut le démontrer mais comme il ne faut pas abuser de la patience des gens, nous en resterons là pour aujourd’hui.
Robespierre ne ressemble à rien de ce qu’on en dit, ce qu’on en dit ne représentant jamais que les fantasmes de celui qui parle. Il a sans doute été athée mais ce n’est pas la peine de se battre pour ça (c’est lui qui a dit que pendant ses études, il n’était presque jamais allé à la messe… alors que ses maîtres étaient tous des prêtres et qu’un évêque payait ses études ; lui aussi qui « le soir à la veillée » lisait Voltaire à sa fiancée et à sa petite belle-sœur, chose qu’Henri Guillemin a escamotée d’autant plus volontiers dans sa Légende dorée qu’il ne pouvait pas voir Voltaire en peinture, au point qu’il n’a jamais écrit un mot sur Saint-Just pour ne pas avoir à parler d’Organt.).
La fête de l’Être suprême, sur laquelle on a tant glosé, ne découle pas du caractère, des opinions ni des états d’âme de Robespierre, encore moins d’un caprice de sa volonté, mais d’une impérieuse nécessité politique. La même, exactement, qui a fait porter à Vladimir Poutine, tout au long de son premier mandat, une imposante croix en sautoir. Et Vladimir Poutine est sans doute, lui aussi, athée, chose qui ne doit avoir d’importance que pour lui, éventuellement pour ses proches.
La nécessité impérieuse, c’est l’unité nationale en péril de mort, c’est la nation qui s’atomise, d’où l’urgence de reformer à tout prix un noyau dur au moyen du plus grand nombre possible de citoyens (souvent les moins matures mais c’est une autre histoire) tout en s’appliquant à ne pas léser les autres : le ciment, en l’an II, c’est la religion catholique, c’est le christianisme orthodoxe en 2012 à Moscou et en 1979, à Téhéran, c’est l’Islam. On voit que, dans ces trois cas, il y a volonté de ne pas léser ceux qui sont différents : minorités juives par exemple en Iran, populations juives, athées, musulmanes, bouddhistes et autres en Russie, réclamation du droit de vote pour les juifs, les protestants, les acteurs et le bourreau (chez Robespierre).
Dans la même logique, Staline, qui était croyant, a fait observer en URSS le matérialisme historique décrété par le Soviet Suprême.
Tout groupe d’humains en bonne santé est naturellement centripète. Tout ce qui l’attaque est nécessairement centrifuge : les Girondins en France, les Atlantistes en Russie, et peut-être les Rouhanistes ailleurs : agents de désintégration, agents de mort.
La politique est à la fois un art et une science. Elle a des constantes, qu’on peut suivre à la trace dans l’histoire. Ce n’est pas très difficile, quand on a saisi le mécanisme.
Henri Guillemin croyait en Dieu. Il disait « j’ai fait le pari de Pascal : s’il n’y a rien, je ne le saurai pas, et s’il y a quelque chose, j’espère bien que j’irai au ciel. Où je suis sûr, alors, de trouver Robespierre et pas Jean-Paul II »
Qu’il repose ou chante la gloire de son dieu en paix.
URL de cet article : http://blog.lesgrossesorchadeslesamplesthalameges.fr/index.php/stanislawa-et-la-revolution/
6 mai 2021


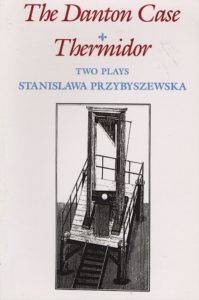
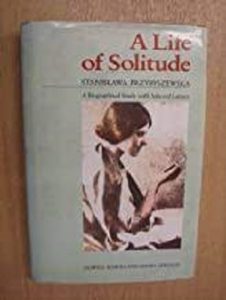






0 Comments