Qui a peur d’Elsa Triolet ?
prophétesse de l’avant-garde situationniste
Jean-Louis Lippert – alias Anatole Atlas
Un soir, je passais sur le boulevard du Montparnasse. J’aperçois de loin une foule attroupée autour de La Closerie. J’approche. Les gens regardent en l’air : devant la fenêtre du premier étage, un jeune homme brun, mince, en smoking crie : « Vive Abd el Krim ! ». Des agents se forcent un passage à travers la foule. « Vous entendez, il crie “Vive l’Allemagne ! ” ». La foule, menaçante, grommelle. « Mais non, il parle du Maroc. » Le jeune homme disparaît. Des gens serrés entre des policiers sortent du café. La foule se bouscule et crie… J’ai fait, trois ans plus tard, la connaissance de ce jeune homme qui criait par la fenêtre des mots indistincts sur un sujet mal défini. Alors, naturellement, La Closerie des Lilas est pour moi autre chose qu’un café…
Ces lignes non datées furent écrites en 1928 ou 1929, quelques années après la scène qu’elles évoquent : ce banquet devenu célèbre en l’honneur du poète Saint-Pol Roux, qui eut lieu le 2 juillet 1925. J’ai lu quelques phrases et nous avons entendu une histoire. Par quel sortilège l’histoire d’une femme, évoquant sa première rencontre avec un homme, appartient- elle à l’histoire universelle ? Car tous les manuels vous le diront : le scandale déclenché par le groupe surréaliste à cette occasion n’a pas fini de retentir dans la mémoire collective. Pour se faire une idée du séisme intellectuel provoqué par les imprécations lancées alors contre les seules opinions admises, et relayées le jour même par un manifeste de la revue Clarté contre la guerre du Rif au Maroc, il faudrait imaginer de nos jours l’émoi provoqué par une manifestation publique où retentirait par exemple ce cri : « Vive l’islam soviétique ! ».
D’emblée nous sommes dans le vif du sujet. Quelle parole peut-elle avoir ce pouvoir magique de faire exploser la contingence des circonstances où elle fut proférée, pour gagner un statut lui conférant une aura d’éternité ?
Plus tard, la dame (dont j’ai pris quelque liberté avec les mots de dire que la première rencontre avec l’imprécateur eut lieu ce jour-là de 1925, car elle ne fit alors que l’apercevoir et, ayant lu son Paysan de Paris, ne se le ferait présenter dans un autre café – la Coupole – que trois ans plus tard), cette dame écrirait à propos de cet homme des phrases qui resteraient gravées dans le marbre : « Quand côte à côte nous serons enfin des gisants, l’alliance de nos livres nous unira pour le meilleur et pour le pire dans cet avenir qui était notre rêve et notre souci majeur, à toi et à moi. La mort aidant, on aurait peut-être essayé et réussi à nous séparer plus sûrement que la guerre de notre vivant : les morts sont sans défense. Alors, nos livres croisés viendront noir sur blanc, la main dans la main, s’opposer à ce qu’on nous arrache l’un à l’autre. »
Chacun de ces mots dont vous savez sans doute, chers amis, qu’ils sont tracés sur la tombe d’Elsa Triolet et de Louis Aragon, en un lieu du parc entourant le moulin de Saint-Arnoult-en-Yvelines décidé par la foudre, puisque l’orage y ayant abattu un grand arbre, c’est à cet endroit qu’elle lui demanda que fût creusé dans la terre leur lit d’au-delà, chacun de ces mots réclamerait plus d’un colloque des ombres pour faire lumière sur une œuvre à jamais croisée contre le sens commun du mot croisade…
*
Comme jamais il n’est arrivé à aucun autre couple, deux vies se sont tissées d’histoires dans l’histoire de leur siècle, jusqu’à ce point de fusion confinant au surnaturel où Jean-Sébastien Bach fut prié d’envoyer ses Sarabandes, par le violoncelle de Mstislav Rostropovitch, voltiger autour de la tombe d’Elsa Triolet peu après sa mort le 16 juin 1970. Qui d’autre qu’elle aurait-il pu voir accourir les fantômes d’une cour amoureuse l’ayant accompagnée tout au long de sa vie ? Le premier d’entre eux, c’est Maïakovski, rencontré lorsqu’elle avait quinze ans, dont Elsa rappelle plusieurs fois combien la hantait le vers du poème De Ceci » Ressuscite- moi « , jusqu’à en rêver chacune des nuits qui suivirent son suicide en 1930; puis, dans l’ordre des préséances non chronologiques,surgit l’initiateur Maxime Gorki, qu’entourent les visages d’Essénine, Isaac Babel, Victor Chklovski, Khlebnikov, Pasternak, Roman Jakobson, Chagall, Tzara, Léger, Duchamp, Péret, Matisse, Chaplin, Picasso… Suivent alors d’humbles admirateurs : Sartre, Camus, Cocteau, Mauriac.
Pour ne pas énumérer la cohorte entière de noms qui font le dictionnaire artistique et littéraire du XXe siècle, dont l’amitié démentit le jugement porté sur elle par le seul tribunal ayant de nos jours autorité, celui d’une Inquisition médiatique sacralisant des figures féminines plus conformes aux intérêts servis par ce clergé : Beauvoir, Sagan, Duras, Nothomb… (C’est ainsi qu’un dénommé Pierre Assouline, exemple de plume serve s’étant emparée du pouvoir symbolique, dans un best-seller qui recense l’histoire du Prix Goncourt, se devait d’insulter Elsa Triolet en attribuant le prix de 1944 mérité par Le premier accroc coûte deux cents francs, aux seuls faits que son auteur ait été d’origine russe et communiste.) Mais s’il faut d’abord sombrer dans la vie avant de naître à la création, Elsa Triolet commence par donner à ses détracteurs son approbation. Tout son Journal, tenu par intermittence, atteste un combat qu’elle croyait perdu d’avance contre le malheur public et intime.« Le mal que vous font les mots, les arrière pensées, les regards, les intentions, les racontars, les jugements des autres… », écrit -elle le 6 novembre 1938, jour du dixième anniversaire de sa rencontre avec Aragon. Quelques semaines plus tôt, elle notait : « Il pèse sur ce que j’écris une espèce de malédiction ». Thème obsessionnel qui revient dans ses Souvenirs sur Maïakovski pour éclairer les souffrances de ce dernier :« Les gens (…) qui grignotent votre vie par leurs jugements, leurs suppositions, des racontars, la diffamation… »
Si maintes héroïnes d’Elsa Triolet sont victimes de ce « mal que vous font les gens », lui faisant multiplier dans son œuvre l’allusion à une phrase de Tolstoï : « Dieu voit la vérité mais n’est pas pressé de la dire », c’est qu’à rebours de l’interprétation dominante, qui verrait dans cette attitude les symptômes d’un délire paranoïaque, une lecture opposée place l’écrivain de génie dans la position légitime de juger les turpitudes et bassesses humaines du point de vue absolu d’une exigence de justice et de vérité. C’est en fonction d’un tel renversement de perspectives qu’il est urgent de lire celle dont le thème essentiel, toujours selon son Journal, fut « le rapport avec les gens de quelqu’un qui serait comme une écorchée vive, qui marcherait pieds nus sur du verre brisé… »
*
Peut-on imaginer constat plus lucide et précis du sort communément partagé par la plus grande part des humains, que celui d’une marche à pieds nus sur du verre brisé ? N’en faut-il pas déduire qu’une fulgurance visionnaire puisée dans la plus singulière expérience d’exil, révèle une vérité commune à tous, même si la majorité refuse une telle révélation ? Dès lors cette œuvre mise au ban sur soupçon de délire, ne serait-elle pas occultée pour la raison même qu’elle dénonce une démence collective ? Car ceux qui font les distinctions et les réputations, ne sont-ils pas aux ordres des puissances qui brisent toute vie comme du verre et dressent les victimes à se résigner d’une marche forcée sur leurs propres débris ?
De telle sorte qu’apparaisse comme scandaleuse et inadmissible une parole féminine, travestie dans de multiples personnages, osant proférer ce qui n’était réservé qu’aux prophètes bibliques : « Je suis la vérité »… Voilà sans doute pourquoi l’une des plus géniales créations de tous les temps, qui est de notre temps – je parle de l’Œuvre croisée de Louis Aragon et d’Elsa Triolet – demeure invisible à ses contemporains. Chacun croit-il avoir en mémoire telle rengaine rendue célèbre par la chanson populaire, puis devenue maxime honorant les discours, comme « la femme est l’avenir de l’homme » ? Nul ne s’avise d’en chercher l’origine dans la bouche d’un mejnoun voyant l’avenir depuis Grenade en 1492, prédisant à cinq siècles de distance l’existence de celle pour qui fut écrit Le Fou d’Elsa, quatre décennies après le cri « Vive Abd el Krim »… Or, à creuser encore, n’a-t-on pas la surprise de découvrir dans le Journal d’Elsa Triolet cette note au temps de sa rencontre avec Aragon : « Les femmes, c’est l’avenir du monde. Leur force n’est pas découverte mais est-ce que l’électricité a toujours été connue ? »
Je ne résiste pas à l’envie de vous lire le début de cette page : « J’aime être heureuse avec un homme (…) on est sur la limite de l’au-delà… ». Tiens donc ! Dans sa postface au cycle romanesque Le Monde Réel, en 1966, Aragon ne définit-il pas le roman comme « un langage qui ne dit pas seulement ce qu’il dit, mais autre chose encore, au-delà » ? Cette même postface, pouvait-elle ne pas se conclure (trouver son au- delà), par une très longue citation d’Elsa tirée de son dernier roman alors en date – Le Grand Jamais – évoquant la question de la vérité L’idée de cet au-delà reprise aux religions qui se l’étaient approprié, ne serait-elle pas la clé d’une œuvre au seuil de laquelle nous sommes, où la réunion de ce soir nous convie sur invitation de ses auteurs ?
*
Soit une femme et un homme vivant sans se connaître dans la capitale de la Révolution française en 1924. Il achève la première déclaration surréaliste Une vague de rêves, avant le Manifeste officiel d’André Breton. « Qui est là ? Ah très bien : faites entrer l’infini » sont les derniers mots d’un texte oraculaire proclamant : « Il s’agit d’aboutir à une nouvelle déclaration des droits de l’homme ». Ces phrases ne sont-elles pas toujours en surplomb de notre monde crépusculaire ? Elle, venue de la capitale de la Révolution russe, ne s’est alors jamais confiée qu’à son journal intime. Il s’y note l’ennui d’une jeune femme très influencée par ce trait marquant de la littérature de son pays, depuis l’insurrection des Décembristes en 1825 et leur condamnation à l’exil : une mélancolie nourrie de ce que Pouchkine, par la voix d’Eugène Onéguine, appelle russkaïa khandra, terme intraduisible résumant un ensemble de pensées et de sentiments désabusés, dont les publicistes russes caractériseront le type du lychnyi tchéloviek – homme inutile, ou homme en trop, veuf de toute espérance. La jeune dame en exil à Paris tient de ce personnage romanesque. Elle n’a pas encore senti combien le Que faire ? de Lénine répondait au même titre utilisé déjà par Tchernychevski, dans une acception non dénuée d’ironie qui renversait le sens du désenchantement pour le transmuer en énergie révolutionnaire…
Ces données me paraissent essentielles pour situer d’emblée les deux pôles entre lesquels s’inscrira l’inspiration d’Elsa Triolet. D’une part, même au temps du pire triomphalisme stalinien, sa lucidité critique sera toujours en éveil, aiguisée par une conscience de la noirceur des choses que masquent les apparats idéologiques : j’y vois la persistance en elle de
cette mélancolie désabusée propre au lychny tcheloviek ; d’autre part, sous les coups de butoirs du plus sombre désespoir, aux heures noires des combats de la Résistance, toujours en elle veillera la flamme d’un courage physique et intellectuel quelquefois surhumain, que le futur sera bien obligé de relier au formidable optimisme historique né de la révolution soviétique. Ainsi, tout à la fois militante bolchevik et porteuse de stigmates aristocratiques, naviguera cette femme éperdue d’absolu dont l’œuvre sans pitié démasquera fausses noblesses et religiosités hypocrites à quelque camp qu’elles appartiennent. Ainsi, me semble-t-il, introduira-t-elle dans la littérature occidentale un type de personnage à ce point complexe qu’on n’ose encore l’apercevoir. Mon hypothèse ? Elsa Triolet, lestée de l’expérience vécue dans le tourbillon de la révolution russe, inventa l’avant-garde radicale qui exploserait en Mai 68.
*
On le lui pardonnerait d’autant moins qu’est puissant le tabou entourant toute velléité de décryptage en profondeur de ce qui se joua cette année-là. L’histoire n’est-elle pas toujours – selon ses mots – « reconstituée du point de vue de la pensée dominante » ? En sorte que l’enjeu de cette aventure qu’est l’exploration des univers créés par Elsa Triolet, me paraît être une élucidation possible du monde où nous vivons aujourd’hui. Qu’une œuvre écrite, pour sa part essentielle, au cours du gros quart de siècle ayant précédé les insultes vulgaires lancées à Louis Aragon, dans le Quartier latin, par un loustic nommé Daniel Cohn-Bendit voici près de 50 ans ; qu’une œuvre, sans doute ignorée par cet actuel notable du néo-libéralisme, porte en elle un éclairage décisif pour comprendre la genèse du capitalisme libertaire : n’est-ce pas une raison de l’ostracisme dont la frappe le milieu littéraire ? Car le génie fait peur, qui rayonne bien au- delà de l’espace où l’on croit pouvoir le confiner dans l’ombre de l’oubli. Qu’on ne m’en veuille donc pas si j’évoque ici la dérive, cette notion-clé des avant-gardes au siècle passé. Même si Dany-le-Rouge a lancé sa carrière publique en se faisant le porte-voix des idées situationnistes sans trop les comprendre, nul mieux qu’Aragon n’illustra la dérive à l’époque surréaliste ; et personne plus qu’Elsa ne l’avait mise en pratique bien avant qu’un Guy Debord n’en fît la théorie, limitée aux cafés de Paris… C’est ainsi qu’à l’âge où, d’ordinaire, s’élaborent les projets d’existence, Elsa, pour ainsi dire, avait déjà dérivé quelques vies sur trois continents. Tourbillons d’une vie familiale polyglotte, cosmopolite et voyageuse durant l’enfance ; séismes politiques et culturels dans l’adolescence ; liaison avec un officier français juste après la Révolution ; départ en bateau depuis Petrograd « crevant de famine et de choléra » ; mariage à Paris ; croisière au long cours vers Tahiti, passant par New York et San Francisco ; retour à Paris, divorce ; errances à Londres et Berlin dans le milieu de l’émigration russe ; bohème à Montparnasse en l’hôtel servant d’antre à Marcel Duchamp : c’est là qu’en 1924, le Journal d’Elsa note : « J’ai vingt-huit ans et je m’ennuie terriblement avec moi-même (…) Je ne révère pas Dieu mais l’enchaînement des choses. Il existe un lien entre les faits, et c’est cela que je vénère, que je crains et que j’aime ».
*
Selon ce mystérieux enchaînement des choses dont il revient à l’art de capter les signes épars pour tenter d’en extraire la quintessence du sens, il est possible qu’Elsa visite les collections russes du Salon d’Automne en compagnie de Maïakovski cette année-là. Dans sa correspondance avec Maxime Gorki, s’ébauche un projet littéraire fondé sur le principedu montage entre des éléments éparpillés de la réalité, mis en honneur par cinéastes et photographes soviétiques. Tout aussi plausible est qu’elle croise alors le chemin de James Joyce à la librairie Shakespeare & Co près de l’Odéon, Joyce qui vient de faire publier confidentiellement son Ulysses par Adrienne Monnier, propriétaire de cette librairie promise à devenir mythique. Les deux exilés – que séparent quatorze ans d’âge – ne sont-ils pas engagés dans une démarche expérimentale comparable, celle qui exige d’inventer des formes romanesques inédites, précisément parce que l’important n’est pas de retranscrire les choses mais de traduire les relations entre elles ? Ainsi prennent corps les trois premiers romans d’Elsa Triolet, écrits dans sa langue natale et publiés à Moscou. Ces récits mêlent à l’autobiographie des éléments disparates convergeant versla recherche d’un sens global qui échappe toujours à Elsa, profondément affectée par la russkaïa khandra. N’y sont pas étrangères les conditions de vie précaires et l’ambiance de l’hôtel Istria, repère de Duchamp, Man Ray, Picabia. « Prologue au suicide », avoue-t-elle de Camouflage, le dernier livre écrit en russe, où resurgit l’obsessionnelle interrogation sur le devenir de la femme que l’on avait notée dans son Journal. Cet « océan de nostalgie » propre à une définitive étrangère permet l’envol, dans le tumulte occidental, d’une voix de conteuse orientale. Occident et Orient ne sont pas ici des déterminations géographiques mais symboliques. « Shéhérazade ô récitante », écrira plus tard Aragon dans un poème dont elle agrémentera une préface de son Cheval blanc. Car la rencontre avec cet homme a eu lieu, seul salut pour deux désespoirs. Et la mort de l’écriture en russe deviendra source vive d’une renaissance de l’imaginaire russe en langue française. Elsa n’est-elle pas la pionnière,bien avant Romain Gary, puis tous les autres, d’un vaste mouvement de transglossie – pardonnez ce néologisme – vers notre littérature ? Il s’en faudra d’une décennie (au cours de laquelle Elsa Triolet traduit en russe le Voyage au bout de la nuit), pour que s’écrive et paraisse en français Bonsoir Thérèse. Si j’ai déjà parlé de dérive, on peut dire de ce titre qu’il s’agit d’un détournement – cette autre notion majeure de l’avant-garde…
Elsa confierait qu’un jour, écoutant une émission radiophonique, elle entendit une voix, qui n’était alors pas destinée à être captée par le micro, prononcer : « Bonsoir Thérèse ». Sans plus de signification pour l’auditeur que ceux, nous dit-elle, surpris derrière la cloison d’une chambre d’hôtel, ces deux mots chuchotés par l’animateur à une collègue retentirent en elle comme un signe attestant la plurivocité du réel, tant les conditions de vie modernes jouent à télescoper les dimensions multiples de la réalité, ce dont une des missions de l’écrivain consiste à témoigner. Dans le roman qui détourne ainsi deux mots de leur contexte initial en les prenant pour titre, Elsa fait usage de slogans publicitaires, de paroles de chansons captées au hasard, ainsi que du collage d’une histoire imprimée en italiques, sans rapport apparent avec ce livre où rôdent les solitudes féminines. « Une sorte d’échappée fantastique au sein du récit », dira plus tard Aragon de ce procédé, non sans avouer qu’il s’en inspirera lui-même dans La Mise à mort et dans Blanche ou l’oubli…
Le thème essentiel de Bonsoir Thérèse – un appel à la femme future – illustré par ce chef d’œuvre absolu qu’est Le Fou d’Elsa, ne fera-t-il pas sa gloire en gagnant la mémoire collective grâce à sa mise en chanson ? « Les femmes – c’est l’avenir du monde », réitère en effet la narratrice de ce roman nimbé de « la lumière étrange » d’une époque…
La littérature française de l’immédiate avant-guerre – bruissant alors de La Nausée de Sartre – vit donc surgir l’œuvre expérimentale d’une inconnue qui à elle seule justifierait aujourd’hui la célébrité de son auteur si celui-ci avait cessé d’écrire. Hélas pour la réputation d’Elsa Triolet, elle ne s’en tint pas là. C’est lesté d’une lucidité qu’il faudrait qualifier de terrifiante, que le couple formé de Louis et d’Elsa voit s’avancer la tuerie programmée. Car ils savent, l’un et l’autre, les dessous de l’affaire, depuis la Der des Ders. Ensemble ils ont mis toutes leurs forces dans le combat contre le fascisme depuis le Congrès de Kharkov en 1930, et l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires fondée trois ans plus tard. Ensemble, ils ont porté secours aux antifranquistes à Valence et Madrid en 1936. La Bête immonde, ils en connaissent d’autant mieux les occultes rouages qu’a pris le pouvoir, au royaume des Lettres sous occupation nazie, l’ancien familier d’Aragon nommé Drieu la Rochelle…
*
S’étonnera-t-on du fait que celui-ci reçoive aujourd’hui les honneurs de la Pléiade, quand des tombereaux de haine recouvrent le souvenir d’Elsa Triolet ? Louis Aragon révèle que les premiers mots d’un texte écrit par elle au début de la guerre lui donneraient le courage d’entamer Aurélien. La nouvelle en question (Le destin personnel) fait partie du recueil Mille regrets, que l’éditeur Denoël aurait le grand courage de publier en 1942. Mille regrets, c’est le premier Nuit et Brouillard. Quatre nouvelles d’une noirceur sans illusion. Ce qu’il advient des vies quotidiennes avalées puis livrées au combat de survivre dans le ventre de la Bête. Même si dans la clandestinité s’organise un Comité national des écrivains, de même qu’avec Jean Paulhan et Jacques Decour se créent Les Lettres françaises, et même si Elsa – d’abord contre l’avis de Louis – veut prendre une part physique active à la Résistance, Mille Regrets ne s’en fait guère l’écho. Nous sommes au plus profond des cercles de l’enfer, dans une « longue insomnie » de cauchemar striée par un grand rire qui glacerait d’effroi quiconque de nos jours oserait lire l’histoire intitulée Henri Castillat. Ce jeune séducteur cynique et arriviste, cueillant tous les succès mondains par un art consommé de l’esbroufe lui faisant exploiter les opportunités d’une atmosphère de terreur, vivant sans temps morts et jouissant sans entraves en professant avant la lettre la devise « interdit d’interdire », dont les livres ont fait « l’espoir de la littérature française », et qui sans foi ni loi s’en va conquérir l’Amérique, n’est-il pas un portrait des plus actuels ? Fuir la vie des sans dents pour croquer sans complexe à pleines mâchoires une existence de parvenu : dans ce personnage postmoderne, Elsa ne tend-elle pas un miroir à nos social-démocraties libéralitaires ?
*
Chaque siècle produit un petit nombre de livres hors-mesure que ne voient pas les contemporains, tant ils surplombent leur époque. C’est le cas du Cheval blanc, publié l’année suivante. Cette somme romanesque où se cristallisent toutes les expériences d’une vie hors du commun, serait aujourd’hui considérée comme un monument littéraire si son auteur ne s’était fâcheusement nommé Elsa Triolet. Sous la censure de Vichy, son génie s’est ingénié à imaginer un héros médiéval – conforme donc en principe à l’idéologie de l’Occupant – livrant son combat dans les conditions modernes. Quel combat ? Celui d’un chevalier errant, monté sur son mythique cheval blanc, rêvant de libérer une belle aux tresses blondes captive de quelque donjon gardé par un féroce dragon.
« Ce n’est pas d’une étincelle qu’il est né, mais des braises de tout ce qui a brûlé autour de moi », écrira Elsa dans une préface vingt ans plus tard. Le destrier de ce Michel Vigaud étant plutôt la moto, et son armure une veste de cuir, on ne s’étonnera pas si Elsa Triolet confiait dans la même préface qu’en cas de transposition cinématographique, « pour incarner ce jeune homme pris dans son époque, il aurait fallu un James Dean ». Car, à lire ce roman sans savoir quand il fut écrit, comment ne pas croire qu’il le fut au moins dans la décennie qui suivit ? C’est ici que s’ébauche en effet la mythologie de Saint-Germain-des-Prés, dans une dérive où la Russie, l’Afrique et l’Amérique ne sont pas moins visitées que la France. Les traits de l’aventurier sans attaches et désabusé, radicalement privé d’autres illusions que ses propres chimères inventées, ne me laissent aucun doute sur le fait qu’il inspira le jeune Guy Debord au moment de créer son propre mythe. Selon cette hypothèse, Elsa Triolet prophétisa au début de la guerre, ce qui serait codifié comme style de vie situationniste. Vous ne voudriez pas que l’on portât cet exploit à son crédit, quand le même Debord est tenu par tous les médias pour l’éclaireur de nos temps ! Cette effervescence de liberté qui exploserait au lendemain de la défaite nazie à Paris, qui mieux que Michel Vigaud la préfigure ? Encore est-on loin des clichés de magazines grâce auxquels se négocie de nos jours une imagerie frelatée. Les plus hautes ressources de l’écriture sont ici mises en œuvre dans la peinture de ce preux chevalier combattant pour délivrer un peuple – et sa Belle – du monstre de l’Apocalypse. Guy Debord lui-même n’aurait-il pas recours à cette symbolique médiévale ? Bien sûr – et nous touchons au nœud des raisons qui feraient occulter son modèle – Elsa Triolet avait une avant-garde d’avance. Et les échauffourées de la critique se voulant radicale sur la rive gauche de la Seine dans les années 60 manquaient de répondant si on les comparait aux éruptions de lave incendiaire surgies cinquante ans plus tôt sur les bords de la Neva et de la Moskova. Car il y a du Maïakovski dans le héros du Cheval blanc. Ce qui confère à cette figure surnaturelle la fragile puissance d’une intégrité primitive l’autorisant à anticiper On the Road de Jack Kerouac, pour incarner le premier beatnik. D’autres références à des créations ultérieures sautent aux yeux tout au long de la lecture. Ici vous trouverez À bout de souffle et là Pierrot le Fou pour le même prix. Cette attitude poétique face à la ville : « Il se sentait à Paris comme au bord de la mer pendant le reflux : c’était si intéressant de voir les rues, les places qui ont été le fond de la mer ». N’entend-on pas « sous les pavés la plage » ?
*
Mais il est une autre voyance extralucide chez Elsa Triolet. À l’heure où les discours officiels de l’Occident rivalisent dans l’immonde avec ceux prétendant représenter la voix de l’Orient, c’est à une conteuse orientale qu’il revenait d’exprimer le génie du regard occidental. Fidèle à l’esprit d’Homère, Dante, Cervantes, Erasme et Shakespeare, une ambassadrice de la langue de Pouchkine s’en est venue au pays de François Villon, chez son légataire Aragon, rappeler l’universel message de Goethe en son Divan oriental-occidental, sur la nécessité – interne aux Lumières (Aufklärung) – de s’inspirer de la culture de l’autre pour se définir soi-même. Encore un rappel inconvenant de nos jours pour ceux qui dressent l’opinion contre l’islam et la Russie. Aussi la Sensure a-t-elle changé d’initiale depuis la Propaganda Staffel de naguère. La censure du sens, organisée contre ce génie, cet esprit, ce message des plus grands aèdes européens, n’est-elle pas complice des barbaries qui frappent le monde aujourd’hui ? La Bête immonde ne prospère que de l’ostracisme jeté sur qui rêve un Cheval blanc. Dans le parcours de l’œuvre d’Elsa Triolet, nous arrivons en 1943, la décisive année de Stalingrad. Ce n’est plus trahir un secret que d’évoquer cette scandaleuse vérité : jusque là, si l’on excepte un de Gaulle, toutes les puissances occidentales misaient sur un triomphe du Reich. Ils étaient peu nombreux les écrivains engagés contre ce qui allait de soi : « le groupement des énergies françaises pour l’unité continentale », où l’on se félicitait du fait que l’Allemagne eût entrepris d’«étendre à l’Europe entière le bénéfice des méthodes qui lui avaient réussi ». Cette phraséologie ne vous dit rien ? Dans le cours du récit résonne ainsi une petite phrase : « On n’est pas sûr que la partie se joue contre ceux qu’on croit ». Tout est dit. L’ampleur globale de la guerre exige un regard que sacre le recueil d’Aragon Les Yeux d’Elsa. Celle-ci lui inspire l’exigence de remonter aux sources de la poésie courtoise, qui répondait à la barbarie féodale dans un contexte historique analogue. À ceci près que la femme courtisée par Aragon n’est pas un objet passif d’adoration comme la Laure de Pétrarque, mais une femme libre comme l’était dans la vie réelle Elsa. «Bienvenue dans la littérature du prochain millénaire ! », pourrait-on lire à l’entrée du recueil de nouvelles qui suit : Le premier accroc coûte deux cents francs. C’est un autre détournement qui donne son titre au livre : ce message codé, qui s’était fait entendre à la radio peu avant le débarquement de juin 44, signifiait à la Résistance de passer à l’action. Dans le maquis, Louis et Elsa n’avaient pas attendu !
*
Cela faisait trois ans qu’ils étaient passés à l’action d’écrire et de faire. L’un ne va pas sans l’autre dans l’attitude poétique, si l’on n’oublie pas l’étymologie grecque de ce dernier mot : poïeïn signifie « faire ». Que fait donc Elsa dans son écriture (ne parlons pas ici de son action concrète au sein du maquis, dont déborde ce roman), sinon relier des pôles séparés ordinairement par la culture occidentale ? Ainsi de l’objectivité de son regard pour scrupuleusement décrire les plus infimes détails de la réalité, qui est dans son esthétique une condition nécessaire à l’expression de la subjectivité. De même (on pourrait dire : corollairement), la contingence n’est-elle jamais opposée chez elle à la catégorie de la nécessité, laquelle fonde l’exigence de liberté. Cet usage de la dialectique a des implications éthiques et, bien sûr, politiques. Il en va d’une conception de l’art fidèle à celles qu’en avaient Marx comme le théoricien Georgy Lukacs, mais aussi fidèle à la tradition de la grande littérature russe, de Gogol à Tchekhov en passant par Tolstoï. Tous ces enjeux ne sont rien moins que ceux d’une civilisation contre les barbaries programmées, dont on verra qu’il est trop simple de les réduire à la terreur nazie. Car le tour de force des récits réunis dans Le premier accroc coûte deux cents francs, réside en la prémonition de l’univers dont accoucherait cette guerre. Ce qu’Elsa nous y montre contient déjà les prémices de ce que Michel Clouscard désignerait comme le capitalisme de la séduction, ce marché du désir voué à exploser en Mai 68 avant de modeler la société entière selon les caprices d’une tyrannie libertaire. Fulgurance visionnaire n’étant rendue possible que par les moyens spécifiques du roman poussés à leur paroxysme, en faisant par exemple revenir quelques personnages du Cheval blanc sous un éclairage tragique, dans une scène préfigurant Johnny Hallyday vingt ans avant que la réalité ne fît surgir l’idole des jeunes. Voulez-vous du Mai 68 en l’année 1943 ? « Celui qui aime écrit sur les murs », prononce l’héroïne des Amants d’Avignon, nouvelle que les éditions de Minuit firent paraître à part dans la clandestinité. Rarement le terme de « héros » – et surtout celui d’« héroïne » – n’auront été si à propos que dans ce livre offrant quelques-unes des figures les plus absolues de la littérature, sans jamais trop élever la voix dans l’art de conter leurs exploits. Ces pôles extrêmes de l’expérience humaine que sont féeries surnaturelles et trivialités quotidiennes, quel plus terrible et grandiose cadre qu’une guerre mondiale pour les marier ?
*
Car ce sont bien des contes de fées que les romans d’Elsa Triolet. Ce qui,d’après le sens originel du mot « fée » venant du latin fata, réfère à une volonté divine oraculaire associée à l’expression du destin. Fatales sont ces fables fustigeant à la fois les fausses croyances et ce à quoi ne croit plus une époque dont les scénarios seront bientôt confiés à l’ordinateur. « Il y en a qui ne savent pas, qui ne se doutent pas que le premier accroc coûte deux cents francs, mais la nuit le sait, elle, et elle se trouble et bouge », écrit-elle en l’une de ses intuitions reliant à la logique du jour l’occulte savoir de la nuit comme à la réalité le rêve et la vie à la mort. Comment sa réputation ne dégagerait-elle pas un parfum de sorcière ? Pourtant, l’enchantement de ses mots ne se complaît pas dans le sombre : « Il fait très beau, très bleu et très vert sous un soleil d’or. », cela vous fait-il peur ? Mais c’en est déjà trop pour les agents médiatiques ayant pris le pouvoir symbolique en la République des Lettres, où la médiocrité journalistique supplante aujourd’hui le génie littéraire. Voyez comme le chroniqueur du Goncourt Pierre Assouline l’assassine pour le prix qui lui échoit la seule année où un ouvrage était littéralement hors-concours : la distinction aurait été attribuée au Premier accroc coûte deux cents francs pour la double raison que son auteur était d’origine russe et communiste. Ne peut-on croire que les éminences organisant l’étouffement de cette œuvre sous une chape de malveillance craignent sa substance, dont pâlit presque toute l’actuelle production livresque ? Ainsi d’une prescience de ce que la théorie radicale désignera sous le concept critique de Spectacle, pour caractériser un monde où la réalité s’évanouit en sa représentation : « … l’on dansait avec tant d’ordre et d’élégance qu’on se serait cru devant un écran, devant la projection d’une fête somptueuse et factice ». L’excès de génie nuit toujours à qui en est coupable tant ce genre d’excès répugne même aux mieux intentionnés. C’est ainsi qu’on trouve, dans la Correspondance publiée entre le couple Aragon-Triolet et Jean Paulhan, une réponse d’apparence amicale mais des plus ridicules adressée par ce dernier à Elsa, qui lui avait envoyé Le premier accroc dès sa parution, en mars 1945 ; puis, en été, de très sèches félicitations du même Paulhan, lorsqu’elle eut obtenu le Goncourt. Ne méritait-elle pas déjà ce prix l’année précédente, pour Le Cheval blanc – quand il ne fut pas attribué ? Et l’année d’avant, quand deux livres de femmes paraissaient à Francis Carco devoir l’obtenir : Le Marais de Dominique Rolin et Mille regrets ?
*
L’année 1945 n’est pas achevée qu’Elsa termine un autre livre. Toutes les tragédies vécues dans la clandestinité du maquis s’entrechoquent en elle avec la frivolité des fêtes bourgeoises ayant marqué l’entre-deux guerres, elles-mêmes lestées dans sa mémoire par l’expérience antérieure de la révolution russe, pour constituer un gigantesque magma de lave en fusion dont l’éruption se traduit en incandescentes coulées littéraires. On peut dire de la somme romanesque produite au cours d’une décennie par ce forçat de l’écriture, qu’elle constitue un livre unique de plus de deux mille pages, invisible sur les rayons des librairies. Pareille somme, si elle était publiée de nos jours, davantage qu’un témoignage irremplaçable sur l’Occupation nazie, fournirait un éclairage unique sur la gestation d’une autre forme d’Occupation : celle des esprits. Personne ne m’aime : c’est le testament d’une vedette française de Hollywood, Jenny Borghèze, que découvre après son suicide une amie de toujours, la narratrice du roman portant ce titre naïf. Le tour de force accompli par Elsa Triolet consiste revisiter ici la guerre du point de vue d’un ange. Tel est bien le regard d’Anne-Marie Bellanger, cette narratrice ignorante en laquelle Elsa se déguise avec ruse pour livrer ce récit qu’on dirait d’une candeur virginale et qui lance des flèches au poison mortel à chaque phrase. L’histoire, au premier abord, nous paraît d’une fluidité limpide – non sans rappeler une voix qui dut être chère à l’auteur dans son enfance à Moscou : celle de la comtesse Rostopchine, mieux connue sous le nom de comtesse de Ségur – mais bientôt se fait jour la cruelle ironie cachée sous cette référence. Lastar du cinéma, saisissante préfiguration dans son apparence physique et dans son destin de la future actrice Jean Seberg, était connue comme une sympathisante communiste. Autour d’elle s’agitait un ballet d’ambitions prétentieuses que traverse la narratrice, n’ayant pas assez de ses yeux ni de sa pauvre culture pour en déchiffrer le sens. Or nous sommes encore avant les accords de Munich. Et défilent des scènes dignes de l’Année dernière à Marienbad ou des films de François Truffaut, si ce n’est des Tricheurs, par quoi Marcel Carné souffletterait le cynisme d’une époque nouvelle. « Tout semblait avoir perdu le sens commun, tout n’était que démence et délire » note la narratrice pour qui « c’est le coup de revolver de Jenny qui a donné le départ de la course au malheur ». Septembre 39.Puis la « drôle de guerre » et l’armistice de Pétain, qu’Anne-Marie n’ose juger. « Ce n’est pas l’affaire des femmes, la politique, la guerre. »
*
C’est donc sans idées préconçues qu’Anne-Marie s’offre à la Résistance. Son héroïsme va se déployer dans un autre livre, Les fantômes armés, qui paraît en 1947. Pour évoquer la drôle de paix durant laquelle s’écrivirent ces deux romans n’en faisant qu’un, période propice aux intrigues en tout genre, Elsa notera : « Le monde de la confiance et de l’amitié s’écroulait autour de nous et je butais à chaque pas contre une haine solide et dure, faite de fantasmes, de légendes, de sottise et de malfaisance ».
Car les débuts de la Guerre froide font du territoire culturel un nouveau champ de bataille. Le massacre atomique d’Hiroshima retentit comme un coup de semonce du monde occidental contre l’ennemi soviétique, dont tout allié se voit l’objet d’une suspicion pire que la collaboration nazie. Sur les murs, une affiche du Parti communiste français recourt aux mots d’Elsa Triolet pour se désigner comme « le parti des fusillés ». La grâce et le génie, la noblesse et l’élection divine sont le propre de l’homme et de la femme du peuple, clame son œuvre avec insolence. Profession de foi qui renverse l’idéologie dominante, fondée sur l’expérience vécue de la guerre ayant vu le prolétariat prendre une part décisive dans la victoire sur une Bête immonde ayant bénéficié de l’appui majoritaire du patronat. Jamais la conscience ne fut plus aiguë, chez artistes et intellectuels, d’une responsabilité politique. « Je fais de grands gestes que personne ne semble voir. Il n’y a d’épouvante sur le visage de personne, c’est donc que personne ne voit, ni n’entend » crie la même narratrice que celle de Personne ne m’aime au début des Fantômes armés, placée par l’auteur
dans une situation familiale déchirée. Si son mari, ses enfants, louvoient avec cynisme du côté du profit, l’héroïne se trouve lestée d’un héritage laissé par son amie, la star suicidée. « Des bijoux de mille et une nuits » lui fournissant un expédient pour traverser en somnambule un paysage dévasté. L’Œil imaginal d’Elsa Triolet – j’ai failli dire de Shéhérazade –embrasse la guerre et ses malheurs dans une vision globale (on pourrait dire sphérique) où l’effet de profondeur est obtenu par le télescopage des violences et de la romance. Une brutalité bestiale dénature l’innocence des victimes, l’atrocité du cauchemar s’accentue de la beauté des rêves pervertis, dans un tableau où l’art ne cède jamais à l’idéologie. Car, avec une subtilité sans égale, se déploie la peinture d’une galerie de types humains, d’entre lesquels émerge une figure triolesque entre toutes : celle de l’homme qui ne peut plus s’adapter aux conditions de la paix…
*
C’est lui, nous montre Elsa Triolet, qui deviendra le principal acteur de l’après-guerre. Cet être aliéné sans le savoir par l’absolue barbarie sera le prototype de l’individu atomisé nécessaire à la guerre de tous contre tous qu’exige le marché capitaliste. Mais la démonstration n’a de force que si elle sonne juste à chaque mot, faisant parler tout le spectre de la tragi-comédie humaine. Si je parle de spectre c’est intentionnel, tant, après ce qui fut sous les yeux d’Elsa Triolet, plus aucun humain n’est indemne d’une hantise inscrite aux profondeurs de l’inconscient collectif, celle du retour des Fantômes armés. Ne les voyons-nous pas mener la sarabande qui paraît se confondre au destin de l’humanité ? Personne comme Elsa Triolet, dans le roman du XXe siècle, n’a fait briller l’éclair permettant d’illuminer nos réalités contemporaines. On devine quel électrochoc fut pour Aragon, non seulement sa rencontre avec Elsa, mais la stimulation de ce regard critique sur la genèse et l’élaboration du cycle romanesque Le monde réel. Si leur couple est sans doute le seul dans l’histoire qui naquit avec les pieds dans un siècle pour enjamber un autre et poser son pas dans un siècle ultérieur – le nôtre – en un ballet singulier qui n’est pas près de s’arrêter, ce passage fantomatique n’est guère dissociable des décombres qu’il aura traversés. C’est le thème de l’Inspecteur des ruines, roman qui paraît en 1948. Un homme entièrement ravagé de l’intérieur par cette immense guerre mondiale que fut le XXe siècle en est le héros. De cet homme en miettes, Elsa Triolet dit : « Parmi les personnages par moi inventés, Antonin Blond reste mon préféré ». Laissé-pour-compte, sinistré, cet homme jeune et talentueux «qui porte en lui le cadavre de son âme » échoue, après la fin des hostilités, dans une capitale française au rythme de laquelle il est incapable de s’adapter. Sa dérive le conduit-elle chez un écrivain célèbre qu’il avait naguère injurié ? Celui-ci, grand bourgeois, se fait un plaisir de prendre sous son aile un si beau spécimen d’aventurier qui a « vécu dangereusement ». Les guillemets sont d’Elsa Triolet : son ironie vise un nietzschéisme devenant l’idéologie officielle de la classe au pouvoir. « Bref, j’étais le jeune homme type pour faire le secrétaire d’un homme de lettres couvert de gloire : j’étais un clochard en pantalon de velours et chandail, les cheveux un peu longs, les joues grillées par le soleil, et creuses à souhait ». Dans l’étrange rapport au temps qui est la marque des vrais romans, cette scène anticipe un climat qui prévaudra vingt ans plus tard. La lucidité du narrateur n’épargne rien des impostures d’un maître dont ce « jeune fou » devient bientôt le nègre.
*
Bien sûr, les turpitudes propres à ce milieu renvoient promptement notre héros à la rue, c’est-à-dire dans les bars à épaves peuplés d’intellectuels. S’ensuivent des errances telles que les situationnistes n’auraient jamais le courage de les pratiquer ni le talent de les décrire, une traversée des bas-fonds n’ayant pas oublié les leçons de Maxime Gorki, l’art de poétiser la vie quotidienne qui doit beaucoup au souvenir de Maïakovski. Tout ce que l’avant-garde occidentale paraîtra découvrir en la décennie suivante. Inévitable est la rencontre avec un margoulin proposant d’embaucher Antonin pour un négoce qui promet d’être juteux : tirer profit des ruines de guerre en Europe. Le voilà donc promu inspecteur des ruines. Carrière d’avenir ne pouvant manquer d’exploiter l’abondant marché germanique. Une ville jamais nommée d’Allemagne fournit ainsi son ambiance de conte d’Hoffmann à des constructions de situations qui ont dû faire rêver le jeune Guy Debord. Parmi les ruines au clair de lune rôdent les spectres ne voulant pas qu’on les dénonce comme vivants aux mortels. Mais cette « évasion dans l’irréel » toujours nous ramène au cœur de la réalité, celle d’aujourd’hui. Car « une chose est certaine : pas de communistes ! », si l’on fait confiance à l’auteur pour nous confier l’unique obsession des fantômes qui hantaient ces ruines teutonnes. De retour à Paris se poursuit la dérive en forme de jeu de signes à laquelle Elsa Triolet nous convie jusqu’à l’inéluctable destruction d’un sinistré sans attaches en lequel je vois encore une incarnation du type et du style situationnistes. Ce qui ne manquerait pas d’être connu de tous au cas où subsisterait une véritable critique littéraire. Pareille hypothèse – improbable – s’accompagnerait de la révélation suivante : L’Inspecteur des ruines (selon Francis Carco, qui était membre du jury) avait toutes les chances de valoir un second prix Goncourt à son auteur, si Elsa l’avait publié sous un pseudonyme comme c’était son intention première, devançant ainsi Romain Gary de quelques décennies dans ce genre d’exploit. « J’étais curieuse de savoir comment on jugerait ce que j’écris, sans ma signature, qui semble depuis quelque temps brouiller l’entendement de certaines gens : que je dise noir, que je dise blanc, ils ne voient jamais que rouge. Je voulais me faire lire, d’abord, avec sérénité. J’ai abandonné ce projet », écrirait-elle dans une préface ultérieure. Depuis Bonsoir Thérèse, en moins de dix ans, sept livres d’Elsa Triolet constituent une somme qui, réunie en volume sous le titre L’Étrangère, dissiperait l’opaque brouillard des années 40. On comprend l’agent immobilier Gallimard, en quête des fonds du Qatar, de préférer Drieu la Rochelle dans la Pléiade et Guy Debord chez Quarto...
*
D’autant plus qu’Elsa ne cesserait d’aggraver son cas. « L’homme, assis sur un tonneau de dynamite, fume gaiement cigarette après cigarette, sans prendre la peine d’éteindre les mégots qu’il jette autour de lui. » Par ces mots commence la préface du Cheval roux, référence explicite à l’Apocalypse de Jean l’Évangéliste, publié en 1953. Quels ravages ont-ils pu se produire dans la conscience humaine pour en arriver là ? C’est la question posée par cette contre-utopie de 500 pages, qui est la première anticipation littéraire d’un monde ravagé par la catastrophe nucléaire. Il faudrait lire ici toute cette préface retraçant la genèse du premier Congrès pour la Paix en 1949, l’idée d’Aragon d’une colombe de Picasso comme symbole promis à devenir universel. Nulle part plus que dans cette fable, Shéhérazade ne laisse entendre une voix prophétique, fustigeant « cette espèce humaine qui résulte du croisement de l’aventurier-bandit avec le bourgeois-banquier » : « Hitler n’avait été que leur petit précurseur » ! Cinq ans plus tôt, L’Inspecteur des ruines déjà ne craignait pas de stigmatiser la politique américaine en Europe, coupable d’entretenir la braise du nazisme pour des incendies futurs qui prendraient d’autres formes. Les brasiers d’une chasse aux communistes sont-ils allumés par le sénateur Mac Carthy ? « Oui, je suis l’une de vos sorcières ! » À cet égard, survint un épisode comique des plus significatifs en décembre 1952, lors de la présentation par Charlie Chaplin à Paris des Lumières de la ville. Un acte peu connu fut commis ce soir-là, témoignant d’un esprit de guerre froide sous les apparences d’une contestation d’ultragauche. Guy Debord et les jeunes lettristes y virent l’occasion d’une provocation distribuant un tract ordurier qui traitait Chaplin de « fasciste larvé ». La soirée n’en serait que plus prestigieuse, réunissant le père de Charlot à Louis et Elsa dans l’atelier de Picasso. Ne concentraient-ils déjà la haine d’une prochaine idéologie dominante, laquelle se devrait l’an dernier de célébrer la négation de l’art prônée par Guy Debord dans une grandiose exposition des plus médiatiques à la Bibliothèque nationale de France ? Le sens de ma lecture se précise ici. Car nul mieux qu’Elsa n’explora le dédoublement de la réalité consubstantiel à l’antagonisme entre capital et travail. Un monde contradictoire se déploie sous ses yeux de romancière, où s’impose un système de représentations scindant toute conscience. Que décrit son œuvre, sinon la déchirure entre un univers fantasmatique et la vie quotidienne, ce « bit » russe évoqué par Maïakovski dans son dernier message, pour signifier que s’y était brisée la barque de l’amour ?
*
Il faudra qu’Henri Lefebvre développe ce thème de vie quotidienne pour que Debord s’en empare et en fasse une pièce maîtresse de son dispositif, abusant d’un terme utilisé par Aragon dès 1954 : celui de Spectacle. Un cycle de trois livres y sera consacré, sous le titre L’Âge de nylon. Mais cette schize mentale n’est pas l’apanage du seul capitalisme occidental. Une autre « affaire » de dimension mondiale fournit l’occasion à Elsa de plonger son scalpel dans un chancre idéologique affectant cette fois son propre camp. Staline mort, Aragon prie Picasso de lui fournir un texte. Il offre un dessin représentant le petit père des peuples de manière insolite. Scandale chez les fidèles du communisme vécu comme religion profane. Il faudrait un colloque international pour aborder les questions – toujours d’actualité – soulevées par Le Monument, roman qu’Elsa consacrerait aux rapports entre l’art d’avant-garde et la société, sous forme d’une fable cruelle voyant un créateur en pays de l’Est se suicider pour avoir à ses propres yeux failli dans la mission d’ériger une sculpture digne de sa gloire à Staline. Des tombereaux de critiques ayant jusqu’à ce jour vilipendé le socialisme, il n’est de plus impitoyable que ce livre. L’action se déroulant dans une manière de Tchécoslovaquie, les railleries des Vaclav Havel ou Milan Kundera ne sont rien comparées à la verve d’Elsa pour suggérer l’échec d’un art aux ordres du pouvoir. Certes, est ici condamné ce crime contre l’esprit qu’est l’assujettissement de l’artiste au dogme. « J’ai fabriqué un objet inanimé, inutile, impuissant, muet », se désespère le sculpteur Lewka devant l’absence d’âme de son œuvre, où il croit avoir perdu la sienne. Mais a-t-on mesuré ce qu’implique une telle analyse ? Hors le réalisme socialiste, quelle esthétique dominante échappe-t-elle – à commencer par celle répondant au credo mercantile – au procès instruit par Elsa Triolet, de relever d’une perversion de la foi ? C’est donc la transcendance qu’Elsa réintroduit dans le débat, mettant par là-même en question le stalinisme plus profondément que n’en serait capable l’idéologie bourgeoise – d’un point de vue toujours communiste. Je vois plus qu’une coïncidence entre l’effervescence intellectuelle ayant marqué les débats lors de la parution de ce livre en 1957, et le fait qu’une Internationale situationniste fut créée – contre l’art et le communisme – cette année-là. L’expression société spectaculaire-marchande n’a pas été formulée qu’Elsa la met en scène dans sa trilogie L’Âge de nylon. Roses à crédit paraît en 1959, qui dénonce l’existence atomisée, réifiée, aliénée par le fétichisme des gadgets, jusqu’aux conséquences les plus tragiques. Luna-Park (la même année) met aux prises avec le milieu du cinéma les rêves d’une femme-oiseau s’échappant telle une Icare du labyrinthe vers un avenir utopique. L’Âme, troisième volet du triptyque, pose la question de ce qui est spécifique à l’humain dans un univers envahi par les robots. Comme l’explicitent Les Manigances, intermède à la 1ère personne publié dans l’intervalle de ces trois romans, l’ultime finalité de l’art consiste à capter les liens invisibles sous l’infinité des phénomènes. Une science de l’existence est nécessaire pour approcher l’essence du réel, non sans un regard au laser transperçant les démences ordinaires de la vie moderne en y révélant un contenu tragi-comique, épique et féerique. L’artificialité de ce monde, nous dit Elsa, postule une idolâtrie. Ce caractère impeccable que revêt la marchandise pour se faire adorer, n’est-il pas une imitation des attributs divins, quand bien même il s’agit de camelote ? À l’extrême limite où les contradictions vouent au divorce, à la haine et à la guerre, un appel à l’amour absolu mue le cri du malheur en éclat de rire divin, de sorte que rien de ce qui est humain et divin ne nous paraît plus étranger. Tout ce qui va de l’immanence à la transcendance est du ressort d’Elsa. «Exprimer l’inconnaissable, voilà la tâche de l’artiste », résume-t-elle en faisant s’extasier les personnages de L’Âme devant « l’art sacré dans toute sa pureté ». C’est la réification généralisée d’un monde où règne l’illusion qu’éclaire son troisième œil – l’Œil imaginal de Shéhérazade. En cet univers factice, comment la critique radicale ne serait-elle pas un trompe-l’œil, si elle se voue à détruire l’art et le sacré ? C’est ainsi qu’en Mai 68, Elsa croit utile d’offrir à la jeunesse en révolte un poème de Vélimir Khlebnikov qui, un demi-siècle plus tôt, en appelait à mettre le globe sous la présidence des poètes. Cohn-Bendit répond par l’injure et Guy Debord se fend d’un tract anonyme prétendant ridiculiser Aragon.
Mais si tout n’est que faux semblant dans un jeu de miroirs, la question décisive est de savoir s’il est une issue possible au dédale de l’histoire. J’avance une hypothèse ayant ambition de thèse au terme d’une lecture se voulant sa démonstration : contre le franc-parler trompeur du discours idéologique, le mentir-vrai de l’artiste aura toujours le dernier mot. Car les romans que nous venons de relire anticipèrent un processus de long terme souterrainement à l’œuvre pendant les décennies consécutives à la Seconde guerre mondiale. Ce processus a deux composantes, qui vinrent au jour en Mai 68 et caractérisent l’impasse où paraît bloquée l’histoire. La destruction créatrice, ou innovation destructrice, envisagée comme un moteur objectif de l’économie capitaliste ; et l’individu psychiquement sinistré, qui en est l’agent subjectif. Ces deux aspects intimement liés…
*
Mais l’idéologie dominante les sépare, articulant une euphorie de façade héritée de l’ère antérieure à la fatalité d’une crise insoluble. Il est interdit de renverser le schéma, pour prouver que le désastre humain trouve son origine dans une guerre de cent ans dont nul n’est sorti depuis la Der des Ders, conscience historique à partir de laquelle se pourrait imaginer une alternative à la catastrophe programmée. L’œuvre d’Elsa Triolet fournit cette interprétation, qui offre issue au dédale. Elle est l’un des plus hauts appels à cette conscience dans la littérature du XXe siècle. À partir du modèle hors mesure que fut pour elle Maïakovski, s’élabore un type humain contradictoire dont tous ses personnages précisent l’intuition. Ce type humain pousse à leur paroxysme les postulats de la modernité, mais conserve la nostalgie des origines. Son énergie peut lui faire briser les chaînes de la tradition dans un sens créatif et révolutionnaire, alors que la société ne doit plus sa croissance qu’à une démolition systématique des anciens liens sociaux, dans une démarche destructrice et réactionnaire. Ce conflit se jouait en 1968, à Prague aussi bien qu’à Paris ou à Mexico. Depuis lors, un cyclope aux velléités panoptiques n’a de cesse d’aveugler l’humanité, mais que peut-il contre le troisième œil de Shéhérazade, son Œil imaginal ? Écoutez-voir, nous dit-elle : c’est le titre du roman imagé qu’Elsa publie à l’automne 68. Dans cette iconographie déclinant tous les degrés du trompe-l’œil (dont une photo de Man Ray reproduisant le masque de l’Inconnue de la Seine, aux yeux ouverts), les acteurs du mois de Mai pouvaient-ils imaginer qu’ils étaient à leur insu les prisonniers du piège qu’Elsa leur avait tendu depuis Le Grand Jamais, publié cinq ans plus tôt, qui mettait en scène un historien doutant après sa mort de la véracité de l’histoire, et invitant à la considérer plutôt comme un roman ? Fiction poursuivie cinq ans plus tard par sa femme, dans ce livre « où tout aurait été véridiquement faux » ? Les événements de Mai (nulle part mieux éclairés que par Les Yeux, chapitre du Théâtre/Roman d’Aragon paru encore cinq ans plus tard), trouvent donc leur cohérence ironique en cet ultime triptyque d’Elsa Triolet, conclu en 1969 par La Mise en mots. Le marché ne pouvant plus se passer de muses ni d’égéries, c’est l’image fallacieuse que lui abandonne Elsa dans Le Rossignol se tait à l’aube, dernier chant de l’écorchée vive avant de gagner son brasier de sorcière. Née Ella Kagan (patronyme juif équivalant à Cahen), l’Étrangère porta jusqu’à son dernier souffle au plus haut degré d’incandescence le génie de la judéité, contre le judaïsme d’un Maïmonide qui condamnait à mort enchanteurs et sorcières – soit : le couple de l’aède et de Shéhérazade.
Source : https://www.spherisme.be/Texte/ElsaTrioletProphetesse.pdf
URL de cet article : http://blog.lesgrossesorchadeslesamplesthalameges.fr/index.php/17426-2/
8 mars 2022

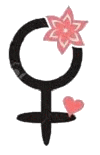
0 Comments