Adieu à tout cela
Illustration de couverture : La France croisée, Romaine Brooks, 1914
(Les Françaises portaient des voiles en ce temps-là. Aujourd’hui, elles se feraient lyncher.)
Robert Graves
Adieu à tout cela
Traduit et postfacé par Robert Pépin
Éditions Autrement – 1998
476 pages
Extraits
Premiers masques à gaz
On nous distribua masques réglementaires et paquets de pansements individuels. Ledit masque réglementaire, le premier dont on se soit servi en France, consistait en un tampon de gaze contenant de la bourre de coton imprégnée de produits chimiques et dont on devait se couvrir le nez et la bouche. Jamais il n’aurait pu arrê ter les gaz que les Allemands utilisèrent contre la division canadienne au cours de la bataille d’Ypres : tout le monde s’accordait à le reconnaître et nous n’eûmes heureusement jamais à vérifier son étanchéité. Une ou deux semaines plus tard, nous reçûmes les « véritables masques à gaz». Il s’agissait en fait d’une manière de sac en feutre gris, couvert de graisse et muni d’une ouverture en mica permettant d’y voir clair : rien pour la bouche, ce qui, à mon avis, devait le priver de toute efficacité. Le mica ne cessait de se fendiller : il n’était pas non plus difficile de voir les trous par où l’on avait fait passer le fil qui le maintenait fixé au casque proprement dit.
Glandes
J’avais déjà cinq mois de tranchées et j’avais passé le « bel âge ». Pendant les trois premières semaines de front un officier était incapable de rendre de grands services. Il se perdait constamment, ne connaissait ni les règles de la sécurité ni celles de l’hygiène et n’avait pas assez d’expérience pour évaluer le danger. C’est à la troisième ou quatrième semaine qu’il donnait le plus de satisfaction à moins d’avoir reçu un ou plusieurs chocs particulièrement sévères. Son utilité déclinait ensuite à mesure que la neurasthénie s’emparait de lui . Au bout de six mois, il se tenait encore à peu près tranquille. Mais après neuf ou dix mois, il n’était plus généralement qu’un boulet que devaient traîner les autres officiers de compagnie à moins qu’on ne lui eût accordé quelques semaines de repos en l’envoyant à l’hôpital ou faire un stage de spécialisation. A partir de douze ou quinze mois, il était pire qu’une baderne. Le docteur R. W. Rivers m’apprit plus tard que cette lente dégénérescence de toutes les compétences militaires trouvait sa cause dans l’action d’une des glandes endocrines – je crois qu’il s’agit de la thyroïde – qui à un moment donné n’arrivait plus à faire passer dans le sang ses vertus sédatives. Privé de ce soutien, l’homme s’acquittait de ses tâches avec apathie et comme sous l’effet d’un stupéfiant, ce qui avait pour effet de lui donner l’illusion d’avoir encore de l’endurance. Mon sang mit une bonne quinzaine d’années à s’en remettre !
Cratère de mine gorgé d’eau
Rencontre avec Siegfried Sassoon
Le bataillon avait déjà reçu son complément de commandants de compagnies et l’on me détacha en qualité de sous-capitaine à la compagnie A commandée par le jeune Richardson. Cette unité est l’une des meilleures dans laquelle il m’ait jamais été donné de servir. Richardson venait de Sandhurst et la plupart de ses hommes étaient des Gallois engagés en 1915. Aucun officier de cette compagnie n’avait plus de vingt-deux ou vingt-trois ans. Un ou deux jours après mon arrivée, je me rendis au mess de la compagnie C où l’on me réserva un accueil amical. Sur une table je remarquai les Essais de Lionel Johnson. Je n’avais jusque-là vu en France que des manuels militaires ou de méchants romans. En dehors de mon Keats et de mon Blake personnels, c’était le premier livre qui n’appartenait ni à la première ni à la seconde catégorie. Je jetai un coup d’œil sur la page de garde : le livre était celui d’un certain Siegfried Sassoon. Je regardai autour de moi pour découvrir l’homme qui pouvait bien s’appeler Siegfried Sassoon et au Premier Bataillon porter Lionel Johnson sur lui. La réponse ne laissant pas de doute, j’engageai la conversation avec lui ; quelques minutes plus tard, ayant quartier libre jusqu’au crépuscule, nous nous mettions en route pour Béthune et parlions poésie.
Siegfried Sassoon n’avait à l’époque publié que quelques églogues à compte d’auteur – pièces pastorales qui sentaient leur XVIIIe-XIXe siècle – et une satire de Masefield qui, oubliant bientôt d’être satirique, s’était transformée en de l’excellent Masefield. Nous nous rendîmes à la pâtisserie et mangeâmes des choux à la crème. J’étais alors en train de préparer la parution de mon premier recueil de poèmes Over the Brazier : j’en avais un ou deux exemplaires sur moi que je montrai à Siegfried. Il fronça les sourcils et me dit que l’on ne devait pas parler de la guerre d’une façon aussi réaliste. Il me montra en retour quelques-uns de ses poèmes. L’un d’eux commençait ainsi :
Revenez à moi, couleurs qui furent ma joie,
Laissez la pourpre de l’homme égorgé …
Siegfried ne connaissait pas encore les tranchées. Je lui dis, en vétéran que j’étais, qu’il changerait bientôt de style.
Bataille de la Somme. Dans une tranchée de communication avant une attaque
Patriotisme et foi
Dans les tranchées, le patriotisme était trop éloigné du réel. On avait tôt fait de s’en débarrasser et de le laisser aux civils ou aux prisonniers. Un bleu qui se mettait à parler patriotisme recevait l’ordre de « la fermer. En tant que « Blighty », concept géographique, la Grande Bretagne évoquait un endroit tranquille et agréable où il faisait bon retourner pour échapper aux misères présentes vécues à l’étranger. Mais en tant que nation, elle sous-entendait non seulement les soldats des tranchées et ceux qui y étaient repartis après avoir été blessés, mais aussi l’état-major, l’Army Service Corps, les troupes affectées dans les boyaux de communication, les unités stationnées à la base et celles qui étaient restées en métropole, sans oublier les civils, et ce jusqu’aux journalistes, espèce détestée et considérée comme la plus vile, aux profiteurs, aux « rayés » des listes d’appel, aux objecteurs de conscience et aux membres du gouvernement. Croyant à la valeur d’une échelle de l’honneur fondée sur la notion de caste et qu’il avait soigneusement établie, le soldat des tranchées n’aurait su concevoir que les Allemands eussent pu de leur côté élaborer une classification rigoureusement identique. À ses yeux, l’Allemagne était une nation en armes, une nation unie et que régissaient les lois d’un patriotisme qu’il ne faisait que mépriser. Il ajoutait foi à la plupart des articles de journaux décrivant les sentiments et l’état d’esprit régnant en Allemagne. Et pourtant, ce qu’il lisait concernant l’apparition d’un état d’esprit et de sentiments identiques en Angleterre ne lui inspirait que peu de confiance, pour ne pas dire pas du tout. Jamais cependant, il ne sous-estima le soldat allemand. Tous ceux qui connaissaient la guerre de tranchées étaient irrités par les calomnies que la presse se plaisait à répandre sur le courage et la valeur des « Boches ».
Sur cent soldats, l’on aurait eu beaucoup de mal à en trouver un seul que les sentiments religieux et même les plus grossiers eussent touché. Même après avoir résisté à l’esprit d’incroyance qui caractérisait les classes que l’on faisait en Angleterre, il eût en effet été difficile de garder la foi dans les tranchées. À Montagne, un adjudant d’active appartenant au Deuxième Bataillon m’avait récemment affirmé que la religion n’avait rien à voir avec la guerre. Il avait ajouté que les négros (il s’agissait là des Hindous) avaient bien raison d’officiellement permettre à leurs hommes de ne pas respecter tous les commandements de leur religion pendant une bataille. « Et toutes ces conneries, sir – excusez-moi, sir – qu’on lit dans les journaux, sir ; et que c’est un vrai miracle de voir que les crucifix au bord des routes sont toujours mitraillés mais que, pour une raison ou pour une autre, le visage de notre Seigneur, n ‘est jamais atteint ; tenez, sir ! Tout ça me flanque mal au ventre ! » Voilà pourquoi un jour qu’il dirigeait un exercice de tir du haut de la colline et qu’il ne se doutait pas que je me tenais derrière lui, il avait hurlé l’ordre suivant : « Hausse à sept cents mètres, un quart de tour à gauche, le mecton sur la croix, rafale de cinq balles, tir concentré. Feu ! » C’est sans doute aussi la raison pour laquelle il avait, non sans humour, remplacé « tir concentré » par « tir consacré ». Toute la section, sans oublier les deux extraordinaires « fanas de la Bible » dont toutes les lettres commençaient par la même formule compassée de « Chère Sœur en Jésus-Christ » ou « Cher Frère en Jésus-Christ », avait tiré à qui mieux mieux.
Si nos hommes étaient tout prêts à croire à la légende du Kaiser mi-clown mi-diable en personne, ils savaient aussi que les soldats allemands étaient dans l’ensemble beaucoup plus dévots qu’eux. Au mess des instructeurs, nous opposions le plus librement le God anglais au Gott prussien, dont nous parlions comme de deux divinités tribales. Nous n’éprouvions que peu de respect pour les aumôniers anglicans du régiment. Nous tombâmes d’accord pour admettre que s’ils avaient fait preuve d’un dixième du courage, de l’endurance et des autres qualités humaines coutumières aux docteurs régimentaires, il eût été tout à fait possible de voir les forces du Corps Expéditionnaire Britannique effectuer un retour en masse à la religion. Mais tel n’était pas le cas : on leur avait en effet enjoint l’ordre d’éviter de se compromettre dans toute bataille et de rester à l’arrière avec le train. Les soldats avaient bien de la peine à respecter un aumônier obéissant à de telles consignes. Et pourtant, sur cinquante de ces derniers, pas un seul ne semblait regretter de devoir se soumettre à ces injonctions. L’après-midi, l’on en voyait un de temps à autre effectuer avec une rare audace une visite dans les tranchées de soutien et y distribuer quelques cigarettes avant de repartir à toute vitesse. Encore fallait-il que la journée fût calme et le secteur fort tranquille. Une fois rentré au cantonnement de repos, il était toujours sur la brèche. Parfois, le colonel lui demandait de partir avec la corvée de rations et d’enterrer les morts de la journée. Il arrivait, récitait son texte et filait comme une flèche. Le respect que la plupart des chefs de corps avaient pour la soutane n’arrangeait rien ; ce respect n’était pourtant pas partagé par tous. En l’espace de quatre mois, le colonel d’un des bataillons dans lesquels j’avais servi se débarrassa de quatre nouveaux aumôniers anglicans. En fin de compte, il fit appel à un catholique romain en alléguant un changement de foi chez les hommes placés sous son commandement. Car non seulement les aumôniers catholiques avaient la permission de visiter les endroits dangereux, mais ils avaient reçu l’ordre exprès de se trouver à tous les postes de combats afin d’être en mesure de donner l’extrême-onction aux mourants. Jamais nous n’entendîmes accuser un seul d’entre eux de ne s’être point acquitté de tout ce que l’on attendait de lui, et plus. Pendant la première bataille d’Ypres, lorsque tous les officiers furent tués ou blessés, le jovial père Gleeson, des Munsters, avait ôté ses insignes noirs et, se mettant à la tête des survivants, avait maintenu la position.
Les aumôniers anglicans étaient singulièrement séparés de leurs troupes. Juste avant la bataille de Loos, l’aumônier du Deuxième Bataillon avait prêché un sermon violent sur le thème de la lutte contre le péché ; à quoi un vieux routier qui se trouvait derrière moi avait grommelé un « Nom de Dieu ! comme si ça ne suffisait pas de s’occuper d’une seule attaque à la fois ! » Un père catholique avait, au contraire, donné sa bénédiction aux hommes en leur disant que s’ils venaient à mourir en luttant pour la bonne cause ils iraient droit au paradis et qu’en tous les cas cela leur épargnerait bon nombre d’années de purgatoire. Lorsque je contai cette histoire au mess, quelqu’un d’autre rapporta qu’à la veille d’une bataille en Mésopotamie l’aumônier avait prêché un sermon sur la commutation des dîmes*. « Bien plus astucieux que cette histoire de lutte contre le péché . Ils n’y avaient rien compris, mais cela leur avait fait oublier la bataille. »
Après avoir passé quelques semaines à Harfleur je me sentis mieux, bien que je susse qu’il ne s’agissait là que d’un repos temporaire et que cette pensée ne cessât de me hanter. Un jour, je quittai le mess pour commencer l’entraînement de l’après-midi sur le terrain et passai devant l’endroit où se déroulaient les exercices de maniement de grenades. Autour de la table où l’on avait préparé les grenades devant servir à la démonstration se tenait un groupe de soldats. J’entendis soudain une déflagration. Un adjudant du Royal Irish Rifles venait de son propre chef de donner quelques petits conseils avant l’arrivée de l’instructeur officiel. Il s’était emparé de la grenade à percussion numéro un et avait dit : « Et maintenant les gars, faut faire attention ! N’oubliez pas que si vous touchez quoi que ce soit pendant que ce petit monsieur se balance dans vos mains, il vous éclate au nez ! » Et pour illustrer la chose, il avait fait cogner la grenade contre le bord de la table. Il y laissa la vie ainsi que son voisin immédiat . L’explosion blessa en outre plus ou moins grièvement une douzaine de soldats.
__________________
* En 1836, le Parlement avait voté une loi autorisant la commutation en rente annuelle des dîmes payées en nature [NdT]
Les Royal Welch Fusiliers au repos – 28 juin 1916
Mules et chevaux
[On se souviendra peut-être qu’en 1940, les colonnes de mulets des Alpes ont inspiré à Curzio Malaparte une de ses plus grandes pages.]
Quatre jours après le coup de main, nous traversâmes Béthune que les bombardements avaient passablement malmené et qui était maintenant pratiquement déserté : nous nous rendions à Fouquières où l’on nous embarqua dans un train pour rejoindre la Somme. La gare de ravitaillement de la Somme se trouvait près d’Amiens et nous poursuivîmes notre route par petites étapes – Cardonnette, Daours et Buire. Dans l’après-midi du 14 juillet nous parvînmes enfin sur le front proprement dit, tout près de l’endroit où David Thomas, Richardson et Pritchard avaient été tués. Le théâtre des opérations s’était déplacé de cinq kilomètres. Le 15 juillet, à quatre heures du matin, nous empruntâmes la route qui reliait Méaulte, Fricourt et Bazentin en traversant la Vallée-Heureuse et atteignîmes le champ de bataille où s’étaient déroulés les derniers combats. Blessés et prisonniers défilaient devant nous dans la pénombre. Le spectacle des mules et des chevaux morts me bouleversa : les cadavres humains, tout cela était bel et bon, mais il me parut ignoble d’entraîner de la sorte les animaux dans la guerre. Nous étions groupés par sections qui avançaient à cinquante mètres les unes des autres. À peine étions-nous sortis de Fricourt qu’un tir de barrage ennemi nous interdit la route. Nous la quittâmes donc et nous engageâmes dans un terrain constellé de cratères d’obus. Nous marchâmes ainsi jusqu’à huit heures du matin et nous nous retrouvâmes alors à la lisière du bois de Mametz où les corps des soldats de nos bataillons de la Nouvelle Armée, qui avaient participé à sa prise, jonchaient le sol. Nous nous arrêtâmes. Un épais brouillard nous entourait. Les Allemands avaient eu recours aux obus lacrymogènes et le brouillard en retenait les vapeurs, ce qui nous fit tousser. Nous tentâmes de fumer, mais nos cigarettes avaient un goût de gaz et nous les jetâmes. Plus tard, nous maudîmes notre erreur. Quels idiots nous avions faits ! En fait, l’affection avait touché nos gorges et non point nos cigarettes.
Lorsque le brouillard se dissipa, nous découvrîmes un fusil allemand où 1’on avait inscrit à la craie : « Premier Royal Welch Fusiliers. » Il s’agissait évidemment d’un trophée. Je me demandai ce qu’il était advenu de Siegfried et de mes amis de la compagnie A. Tout près de là, nous tombâmes sur le bataillon qui bivouaquait. Siegfried était toujours en vie, de même qu’Edmund Dadd et deux autres officiers de la compagnie A. Le bataillon avait pris part à de durs combats : au cours de la première attaque qu’il avait effectuée à Fricourt, il avait débordé notre homologue allemand – le Vingt-Troisième Régiment d’Infanterie. Après avoir, lors d’une ronde, surpris tous les officiers de cette unité terrés à Mametz dans un abri profond au lieu de les trouver dans les tranchées au milieu de leurs hommes, un officier de l’état-major allemand avait expédié tout le monde en première ligne faire un stage disciplinaire . (Edmund Dadd m’apprit que pendant toute la période difficile du mois de mars, il n’y avait eu dans les tranchées adverses aucun soldat ayant un grade supérieur à celui de caporal.) Le deuxième objectif du bataillon avait été le Quadrilatère, petit bosquet s’étendant de ce côté-ci du bois de Mametz. Siegfried s’y était distingué en s’emparant seul d’un front de bandière que le Royal Irish Regiment n’avait pu enlever la veille. Armé de grenades et couvert par le feu de deux fusiliers, il était monté à l’assaut en plein jour et avait terrorisé les occupants de la tranchée ennemie qui l’avaient quittée en toute hâte. Exploit inutile puisque, au lieu de demander des renforts à l’aide de signaux, il s’était assis dans la tranchée allemande et s’était mis à lire un recueil de poèmes qu’il avait emporté avec lui. De retour enfin, il n’avait même pas pris la peine de faire un rapport. Le colonel Stockwell qui commandait alors le bataillon avait tempêté contre lui comme un beau diable. Penser que l’on avait retardé de deux heures l’attaque du bois de Mametz parce que les rapports signalaient que des patrouilles anglaises étaient encore en action. En fait de « patrouilles anglaises », il s’agissait de Siegfried et de son livre de poèmes ! « Je vous aurais accordé la D.S.O. si vous aviez seulement fait preuve d’un peu plus de bon sens » s’était-il écrié fou furieux. Depuis que j’avais quitté le bataillon, Siegfried n’avait accompli que d’héroïques exploits. La Septième Division l’avait surnommé « Jean le Fou ». Il avait été décoré de la Military Cross pour avoir sorti un soldat blessé d’un cratère de mine et l’avoir ramené sous un feu nourri. Je le manquai cette fois-ci ; il était reparti avec le train et prenait du repos. Mais je lui fis parvenir, par l’intermédiaire de l’un de nos propres soldats du train, une lettre rimée ayant pour thème le bon temps que nous prendrions ensemble lorsque cesseraient les hostilités. Je lui racontais aussi comment après nous être reposés à Harlech, nous irions visiter le Caucase, la Perse et la Chine, et lui disais les beaux poèmes que nous écririons. Telle était ma réponse à la lettre rimée qu’il m’avait quelques semaines auparavant envoyée de l’école d’armée de Flixécourt. (On peut la lire dans The old Huntsman .)
Le village de Mametz – Juillet 1916
Blessé et laissé pour mort – Condoléances de l’armée à sa mère
Un éclat d’obus me traversa le haut de la cuisse gauche, tout près de l’aine. Pour ainsi échapper à l’émasculation, j’avais dû être blessé au moment où mes jambes étaient le plus écartées. La blessure que je reçus au-dessus de l’œil fut causée par un petit éclat de marbre, sans doute arraché à l’une des pierres tombales du cimetière de Bazentin. Plus tard, je le fis enlever mais un autre fragment plus petit est depuis lors remonté à la surface, sous mon sourcil gauche où je le garde comme souvenir. Cette dernière blessure dut, ainsi que celle qui fendit l’os d’un de mes doigts, me venir de l’explosion d’un autre obus au-devant de moi. Un éclat d’obus m’avait enfin touché cinq centimètres au-dessous de l’omoplate droite et m’avait traversé la cage thoracique, d’où il était ressorti cinq centimètres au-dessus de mon mamelon droit.
J e n’ai de la suite des événements gardé qu’un souvenir vague.
Il semble que le docteur Dunn ait traversé le tir de barrage ennemi à la tête d’une équipe de brancardiers, qu’il ait pansé ma blessure et qu’il m’ait renvoyé à l’ancien poste de secours allemand situé à l’extrémité nord du bois de Mametz. Je me souviens d’avoir, alors qu’on m’installait sur une civière, adressé un clin d’œil au sergent brancardier qui venait de dire : « Le vieux Gravy a son compte. » Ma civière fut déposée dans un coin du poste de secours où je restai inconscient pendant plus de vingt-deux heures.
Fort avant dans la nuit, le colonel Crawshay revint du bois des Freux et visita le poste de secours. Il me vit allongé dans un coin et on lui annonça gue j’étais perdu. Le lendemain matin, le 21 juillet, les soldats qui procédaient au ramassage des morts découvrirent que je respirais encore et me mirent dans une ambulance à destination d’Heilly où se trouvait l’hôpital divisionnaire le plus proche. Les cahots de la route, qui traversait la Vallée-Heureuse et qui tous les trois ou quatre mètres était défoncée par un cratère d’obus, réveillèrent ma souffrance. Je me souviens d’avoir hurlé. Mais lorsque la route redevint meilleure, je sombrai à nouveau dans l’inconscience. Ce matin-là, Crawshay rédigea, à l’intention des parents des six ou sept officiers qui avaient été tués, la lettre de condoléances stéréotypées qu’on leur adressait en pareil cas. Voici celle qu’il expédia à ma mère :
« Chère madame Graves,
« J’ai le grand regret de devoir vous annoncer que votre fils est mort de ses blessures. C’était un soldat très courageux qui s’acquittait bien de sa tâche. Sa disparition nous afflige tous.
« Atteint par un obus qui le blessa grièvement, il a dû mourir alors qu’on le transportait à la base. Il n’a pas souffert beaucoup et notre médecin est parvenu à le rejoindre pour lui porter immédiatement secours.
« Nous passons en ce moment par de rudes épreuves et nos pertes sont élevées. Veuillez croire ici à toute ma sympathie dans la douleur qui vous frappe. Nous avons en lui perdu un valeureux soldat.
« N’hésitez pas à m’écrire si vous pensez que je puisse vous obliger de quelque façon que ce soit.
« Cordialement à vous,
« C. CRAWSHAY, Lt. Col. »
Il dressa ensuite la liste officielle des morts – elle fut fort longue car il ne restait que quatre-vingts hommes au bataillon – et fit suivre mon nom de la mention : « mort de blessures ». Heilly se trouvait en bordure de la voie ferrée. Les tentes de l’hôpital, sur les toits desquelles l’on avait peint une grande croix rouge pour écarter les risques d’un bombardement aérien, étaient plantées à proximité de la gare. Il y faisait en ce beau mois de juillet une chaleur insupportable. J’étais maintenant à demi conscient et mon essoufflement me rappelait ma blessure au poumon. Il m’amusait de regarder les petites bulles de sang qui naissaient lorsque mon souffle s’échappait par les lèvres de la plaie : on eût dit des bulles de savon rouge. Le docteur vint à mon chevet. Il me fit pitié ; il avait l’air de n’avoir pas dormi depuis des jours et des jours .
– Puis-je boire quelque chose ? lui demandai-je.
– Voudriez-vous un peu de thé ?
– Sans lait condensé, murmurai-je.
– J’ai bien peur qu’il n’y ait pas de lait frais, répondit-il d’un air tout à fait navré.
Des larmes de déception me montèrent aux yeux ; je m’attendais à mieux d’un hôpital de l’arrière.
– Voulez-vous boire un peu d’eau ?
– A condition qu’elle ne soit pas bouillie.
– Elle l’est. Et j’ai bien peur de ne pouvoir vous donner aucune boisson alcoolisée dans l’état où vous êtes à présent.
– Des fruits alors ?
– Je n’ai pas vu de fruits depuis une éternité.
Et pourtant, quelques minutes plus tard, il me rapportait deux reines-claudes passablement vertes. Dans un souffle, je lui promis un verger tout entier à ma guérison.
Les nuits du 22 et du 23 furent abominables. Aux premières heures de la matinée du 24, je dis au docteur qui faisait sa tournée : « Il faut que vous me fassiez sortir d’ici. Cette chaleur va me tuer. » Je la sentais me marteler le crâne à travers la toile de tente.
– Du courage ! La seule chance que vous ayez d’en sortir est de rester ici et de ne pas être transporté. Vous n’arriveriez pas vivant à la base.
– Laissez-moi risquer ce transport. Je m’en tirerai, vous verrez .
Il revint une demi-heure plus tard.
– Bon, permission accordée. Faites ce que vous voulez. Je viens de recevoir l’ordre d’évacuer tous les blessés de l’hôpital. Les Gardes semblent avoir eu « du tabac » au bois de Delville et on s’attend à les voir tous arriver ce soir.
Je n’avais pas peur de mourir – il me suffisait d’être honorablement blessé et de rentrer en Angleterre.
[…]
Le seul ennui que me causa ce décès fut que la banque Cox cessa de me payer.
[ …]
Hystérie guerrière des civils – Lettre d’une « petite maman ».
L’Angleterre nous paraissait étrange à nous autres rapatriés. Nous n’arrivions pas à comprendre l’hystérie guerrière qui s’était emparée de tout le pays. Pas un Anglais qui ne tentât de l’extérioriser d’une façon pseudo-militaire. Les civils parlaient une langue qui nous était étrangère : c’était, qui plus est, celle de la presse. Je découvris qu’il m’était à peu près impossible d’avoir une conversation sérieuse avec mes parents. Des extraits d’un seul de ces documents rédigés dans le style particulier à cette époque suffiront à montrer à quoi nous en étions réduits :
RÉPONSE D’UNE MÈRE
À « UN SOLDAT COMME LES AUTRES »
par une « Petite Maman ».
Message aux pacifistes Message aux affligés.
Message aux soldats des tranchées
« Étant donné les innombrables demandes qui lui ont été adressées tant de la métropole que du front au sujet de cette lettre qui a paru dans le Moming Post, le directeur du présent journal a compris qu’il était de son devoir de la remettre entre les mains d’éditeurs londoniens pour la faire réimprimer sous forme d’opuscule. 75.000 exemplaires en ont été vendus en moins d’une semaine par la maison d’édition elle-même. »
Extrait d’une lettre de Sa Majesté :
« La Reine a été profondément émue par la belle lettre de la Petite Maman et Sa Majesté comprend tout ce que ces mots doivent représenter pour nos soldats qui se trouvent sur le front ou dans les hôpitaux. »
Au directeur du Morning Post
« Sir,
« Puis-je me permettre en ma qualité de mère d’un seul enfant – un fils qui très tôt brûla de faire son devoir – de répondre à Tommy Atkins dont la lettre a été publiée dans votre numéro du 9 courant ? Peut-être aura-t-il la bonté de faire part à ses amis dans les tranchées, non pas de ce que pense le gouvernement, non pas de ce que pensent les pacifistes, mais de ce que pensent les mères de la Race britannique de nos hommes qui se battent. Cette voix exige de se faire entendre car elle comprend que nous jouons le rôle le plus important dans !’Histoire du monde, car il est de notre devoir à nous autres qui “enfantons les hommes” de maintenir l’honneur et les traditions non seulement de notre Empire mais de la civilisation tout entière.
« Puis-je dire à cet homme qui, émouvante modestie ! signe : “un soldat comme les autres”, puis-je lui dire que nous autres femmes, qui exigeons d’être entendues, ne saurions tolérer les cris de “Paix! Paix !” dans un monde où la paix n’existe plus ? Le blé qui ondulera sur un sol qu’arrosa le sang de nos braves proclamera que ce sang ne fut pas versé en vain. Point n’avons besoin de monuments de marbre pour nous souvenir. Il ne nous faut que cette force de caractère qui anime tous les mobiles pour conduire cette monstrueuse tragédie mondiale à un épilogue de victoire. Non ! Le sang des morts et des mourants, le sang du “soldat comme les autres” qui s’échappe de ses “blessures légères” ne nous appellera pas en vain. Tous ont payé leur quote-part et nous autres, en tant que femmes, saurons payer la nôtre sans murmurer, sans nous plaindre. Qu’on nous envoie ces “pacifistes” et nous aurons tôt fait de leur montrer, de montrer au monde entier que dans nos foyers au moins il n’y aura pas de ces gens qui veulent “être assis chez soi, bien au chaud en hiver, au frais et bien à l’aise en été”. Il n’y a qu’une température pour les femmes de la Race britannique et c’est le chauffage à blanc ! Avec celles qui déshonorent le dépôt sacré de la maternité, nous n’avons rien en commun. Nos oreilles ne sont pas sourdes aux cris qui sans cesse montent du champ de bataille, qui s’élèvent de la bouche d’hommes de chair et de sang dont le courage indomptable nous est apporté, pour ainsi dire, “à chaque bourrasque du vent”. Nous autres femmes, ne lésinons pas sur la munition humaine, sur ces “fils uniques” qui doivent colmater les brèches. Ainsi, lorsque avant de “monter sur le billard”, le “soldat comme les autres” jettera un dernier coup d’œil en arrière, il verra les femmes de la Race britannique sur ses talons, sûres, fidèles et qui ne se plaignent pas !
« Les renforts de femmes seront, donc, toujours là pour soutenir le “soldat comme les autres”. Nous autres les “gentes nourricières”, nous autres du sexe faible ne voulions pas de la guerre. Il ne nous plaît point de voir nos maisons désolées et de nous faire ôter la prunelle de nos yeux. Combien nous aurions préféré voir nos gamins, ces amours! ces moissons futures ! ces chers bandits ! rester à l’école. Combien nous eussions préféré poursuivre d’un cœur léger nos amusements, nos passe-temps. Mais le clairon les a appelés et nous avons rangé nos raquettes de tennis, nous avons été chercher nos petits bonshommes à l’école, nous avons rangé leurs casquettes et nous avons jeté un œil plein d’amour sur leur dernier bulletin qui disait “excellent” ; nous avons enroulé tous ces trésors dans un drapeau de l’Union Jack et nous avons fermé le tiroir à clef. Nous ressortirons tout à la fin de la guerre. Peut-être le “soldat comme les autres” ne compte-t-il pas sur les femmes. Mais elles ont leur mot à dire et nous avons répondu à l’appel de nos responsabilités. Nous sommes fières de nos hommes et ils se doivent d’être à leur tour fiers de nous. Si les hommes échouent, Tommy Atkins, les femmes, elles, n’échoueront pas !
Tommy Atkins aux Tranchées
S’en est allé résister.
Ceux qui restent ne feront-ils que souffrir ?
Soupirer ? Non ! Oui nous pleurons,
Mais sommes debout ! Nous voulons
Faire face au canon ! Ou alors, mourir !
« Les femmes ont été créées dans le but de donner la vie, et les hommes de la prendre. Aujourd’hui, nous la donnons par deux fois. Il y a peu de chances pour que nous laissions tomber Tommy, oui, peu de chances ! Nous ne flancherons pas d’un iota, mais lorsque la guerre sera finie, il ne devra point nous reprocher, lorsque nous entendrons le clairon sonner “l’extinction des feux”, de nous retirer pour un court, un très court instant, dans nos chambres secrètes et de là, partager avec Rachel la Silencieuse l’angoisse solitaire d’un cœur affligé et une fois encore, contempler la casquette d’école avant d’en ressortir femmes plus fortes pour poursuivre la tâche glorieuse que le souvenir de nos hommes nous a léguée aujourd’hui et pour l’éternité.
« Cordialement . . .
« Une “Petite Maman” ».
COURRIER ET ÉCHOS DE PRESSE
« Il est de la plus haute importance d’assurer à cette lettre le plus grand tirage possible. »
The Morning Post.
« Retient l’attention à juste titre et exprime avec une éloquence et une force rares les sentiments avec lesquels les épouses et les mères britanniques affrontèrent et affrontent encore le Sacrifice suprême. »
The Morning Post.
« Soulève l’intérêt général. »
The Gentlewoman.
« Une lettre qui est devenue célèbre. »
The Star.
« Nous aimerions bien la voir accrochée aux murs de nos salles. »
Hospital Blue.
« Une des plus prestigieuses pages jamais écrites. S’y allient en effet la grandeur d’âme et la profondeur d’une tendresse qui devraient être et qui sont la marque de tout ce qu’il y a de plus noble et de meilleur dans la nature humaine. »
Un soldat en France.
« Florence Nightingale a fait de grandes, de splendides choses pour les soldat de son époque, mais aucune femme n’a fait plus que “Petite Maman” dont la lettre maintenant célèbre, publiée dans le Morning Post, s’est répandue comme une traînée de poudre de tranchée en tranchée. Je prie Dieu qu’elle soit transmise à la postérité car jamais rien de semblable n’a autant touché nos combattants. Je défie quiconque de n’avoir pas de cœur au ventre après cette lecture… Mon Dieu ! Elle nous fait accepter la mort avec joie ! »
Un qui s’est battu et a saigné.
« Digne d’un intérêt bien plus que passager. L’on devrait la réimprimer et l’envoyer à tous ceux qui sont sur le front. C’est un chef d’œuvre qui nous remplit d’orgueil ; une lettre noble, pondérée et pathétique au plus haut point. »
Un «gravement blessé ».
« J’ai perdu mes deux chers fils, mais depuis que l’on m’a montré la belle lettre de la “Petite Maman” une résignation trop grande pour être décrite a calmé ma douloureuse tristesse et aujourd’hui, je redonnerais volontiers mes deux fils deux fois encore. »
Une mère affligée.
« La lettre de la “Petite Maman” devrait être connue aux quatre coins de la terre – une lettre débordante de l’idéal le plus élevé que tempèrent le courage et le plus grand esprit de sacrifice. »
Percival M. Monkton.
« Cette lettre exquise d’une “Petite Maman” augmente chaque jour notre fierté. Nous autres femmes désirons attiser la flamme qu’elle a si gentiment allumée dans nos cœurs. »
La mère britannique d’un fils unique.
Reste à savoir si tous ces signataires étaient des vrais ou des scribouillards (déjà) payés à la ligne.
Maladies vénériennes… Entraînement au combat…
Je pris le commandement d’un contingent de dix jeunes officiers. À ce moment-là, l’on attendait des jeunes officiers, ainsi que quelqu’un en a fait la remarque dans ses Mémoires de guerre, qu’ils fussent de joyeux drilles en matière de vin et de femmes. Ces dix-là faisaient de leur mieux. Trois d’entre eux attrapèrent des maladies vénériennes à la Lanterne bleue de Rouen. Jeunes Gallois issus de parents exerçant des professions libérales, ils avaient été élevés avec rigueur, n’avaient jusque-là jamais fréquenté de bordels, pas plus qu’ils n’avaient entendu parler de prophylaxie. L’un d’eux partageait un baraquement avec moi.
Un soir, il rentra très tard : il était ivre mort et revenait du Drapeau blanc. Il me réveilla et se mit à me raconter ses exploits. « Je n’aurais jamais pu croire, dit-il que l’amour fût une chose aussi merveilleuse !
– Le “Drapeau blanc” ? demandai-je avec irritation et d’un air passablement dégoûté. Alors, j’espère que tu t’es lavé. »
C’était le parfait Gallois.
– Que voulez-vous dire, mon capitaine ? me répondit-il en le prenant de haut. Bien ssûûr que j’me suis lavé la figûûre et les maaiins !
Il n’y avait en France aucune contrainte : ces garçons avaient de l’argent à dépenser et savaient que de toute façon ils avaient de grandes chances de se faire tuer en quelques semaines. Ils ne tenaient pas à mourir vierges. Le Drapeau blanc sauva la vie à des vingtaines de soldats en les rendant inaptes à servir ensuite dans les tranchées. Il y avait toujours foule dans les hôpitaux de la base où l’on traitait les cas de maladies vénériennes. Les hommes de troupe prenaient un malin plaisir à grossir le nombre des aumôniers que l’on y soignait par rapport à celui des officiers combattants.
À l’arène les instructeurs étaient pleins d’enthousiasme pour la poudre et la baïonnette et tentaient de communiquer cette maladie au contingent. Ce contingent se composait en majeure partie ou bien de soldats enrôlés de force ou bien d’anciens blessés. L’on ne pouvait guère en cette morte saison espérer d’eux un tel enthousiasme à leur arrivée. Les principes de l’entraînement avaient été récemment révisés. Le Manuel du fantassin, édition 1914, stipulait gentiment que le but final du soldat était de mettre hors d’état les forces armées ennemies ou de les paralyser. Mais le ministère de la Guerre considéra que cette affirmation n’était plus assez péremptoire pour une guerre d’usure. Les hommes y apprenaient désormais qu’ils se devaient de HAÏR les Allemands et d’en tuer le plus grand nombre possible. Pendant les exercices de maniement de la baïonnette, les soldats devaient faire d’horribles grimaces et pousser des hurlements propres à vous faire « cailler les sangs » en chargeant l’ennemi. Les visages des instructeurs étaient constamment figés en un ignoble rictus. « Fais-lui mal, allez ! Au ventre ! Arrache-lui les boyaux ! » s’écriaient-ils tandis que les hommes fonçaient sur les mannequins. « Et maintenant balance-lui la crosse dans les parties ! Bousille-lui ses chances de survie ! Plus de petits Fritz !… Hhhmmm ! Non ! À te voir le caresser, le câliner de la sorte, n’importe qui penserait que tu le chéris, ce salopard, ce porc ! MORDS-LE, QUE J’TE DIS ! PLANTE-LUI LES DENTS DANS LA VIANDE ET RONGE-LE ! BOUFFE-LUI LE PALPITANT ! »
Une fois de plus je fus fort aise de me voir envoyé dans les tranchées.
La Paix refusée – Un jeune soldat comprend enfin qu’en patriarcat, les fils sont sacrifiés aux pères.
Je fus donc envoyé à Oxford : au collège universitaire Somerville que l’on avait, transformé en hôpital. Là, il m’apparut que j’en avais peut-être fini avec la guerre qui ne pouvait plus maintenant durer très longtemps. L’idée me plaisait et me déplaisait à la fois. Il ne me plaisait pas d’être loin du régiment qui se battait en France. Mais il me plaisait d’imaginer que j’avais une chance d’être encore vivant à la fin de la guerre. Cependant, Siegfried avait lui aussi reçu sa feuille d’embarquement et avait tenté de me suivre au Deuxième Bataillon ; il n’y était arrivé que pour me trouver parti. J’eus le sentiment de l’avoir plus ou moins laissé tomber. Mais il m’écrivit qu’il était indiciblement soulagé de me savoir sain et sauf et de retour en Angleterre.
Nous nous demandions maintenant s’il convenait que la guerre se poursuivît. L’on disait qu’Asquith avait en automne 1915 reçu des offres de paix sur la base du statu quo ante, qu’il avait bien voulu prendre en considération ; mais l’opposition de ses collègues avait entraîné la chute du gouvernement libéral et son remplacement par le gouvernement de la coalition des « Nous gagnerons la guerre » conduite par Lloyd George. Siegfried soutenait avec passion que l’on aurait dù accepter les offres de paix ; j’étais d’accord avec lui. Nous ne pouvions plus voir dans cette guerre un conflit entre deux puissances commerciales rivales ; il nous paraissait qu’en la continuant les jeunes générations d’idéalistes ne faisaient que sacrifier à la bêtise et à l’effroi protectionniste de leurs aînés. Ce fut à cette époque que je rédigeai cette note facétieuse :
« La guerre devrait être un sport réservé uniquement aux hommes de plus de quarante-cinq ans, aux Jessé et non aux David. Eh bien, mon cher père, comme je suis fier de vous voir servir le pays comme un gentleman des plus courageux et être prêt même à faire le suprême sacrifice ! Ah si seulement j’avais votre âge ! Avec quel empressement j’endosserais mon armure pour aller combattre ces inqualifiables philistins ! Bien sùr, l’on ne peut dans les circonstances actuelles se passer de moi ; il me faut absolument rester au ministère de la Guerre et gérer les biens qui vous appartiennent, ô heureux vieillards ! Jusqu’où n’ont pas été mes sacrifices ! soupirerait David lorsque les ancêtres l’auraient en chantant Tipperary quitté pour le front à la tête d’un contingent de guerriers. Voilà ! mon père, mon oncle Salomon et mes deux grands-pères : tous dans le service actif ! Il faut mettre une carte à la fenêtre* ! »
________________
* Pendant la guerre, on lisait sur un petit carton collé à la fenêtre des maisons le nom du soldat qui était parti au front. [N.d. T.]
Hommes de lettres, pacifistes et responsables de la guerre
Pendant le stage que je dirigeai au bataillon, je me rendais presque tous les dimanches au village de Garsington. Les amis de Siegfried, Philip et Lady Ottoline Morrell, habitaient le manoir. Les Morrell étaient pacifistes et ce furent eux qui les premiers me firent comprendre que l’on pouvait envisager la question de savoir à qui l’on devait imputer la responsabilité de la guerre sous un autre angle. Clive Bell, le critique d’art le plus éminent d’Angleterre, était objecteur de conscience et gardait les vaches à la ferme du manoir. On lui avait permis d’accomplir ce « travail qui revêtait une importance nationale » au lieu de partir sous les drapeaux. Aldous Huxley, Lytton Strachey et l’Honorable Bertrand Russell venaient souvent les voir. Aldous était inapte au service ; sans quoi on l’aurait certainement versé dans l’armée comme Osbert et Sacheverell Sitwell, Herbert Read, Siegfried, Wilfred Owen, moi-même et la plupart des autres jeunes écrivains de l’époque dont aucun ne croyait plus maintenant à la guerre.
Un après-midi, Bertrand Russell, qui était trop vieux pour faire le service militaire et n’en était pas moins un ardent pacifiste (mélange rare), se tourna brusquement vers moi et me demanda :
– Dites-moi, si l’on envoyait une de vos compagnies briser une grève d’ouvriers de l’armement et que ceux-ci refusent de reprendre le travail, donneriez-vous à vos hommes 1’ordre d’ouvrir l e feu ?
– Oui. Si rien d’autre ne réussissait. En fait, cela ne serait pas plus grave que d’abattre des Allemands.
– Vos hommes vous obéiraient-ils ? me demanda-t-il fort étonné.
– Ils détestent les ouvriers de l’armement et ne seraient que trop contents d’avoir la chance d’en supprimer quelques-uns. À leurs yeux, ce sont tous des tire-au-flanc.
– Mais comprennent-ils que la guerre n’est qu’une absurdité inqualifiable ?
– Oui. Aussi bien que moi.
Il ne pouvait comprendre mon point de vue.
Lytton Strachey était inapte au service, mais au lieu de laisser les médecins le réformer, il préféra être traîné devant un tribunal militaire pour objection de conscience. Il nous dit l’extraordinaire impression qu’il avait faite à l’audience en gonflant un coussin pneumatique pour protester contre la dureté des bancs. Prié de répondre à l’habituelle question du président : « Je crois comprendre, M. Strachey, que vous vous opposez à la guerre pour des raisons de conscience ? » Il rétorqua (de sa curieuse voix de fausset) : « Oh non, pas du tout, uniquement à cette guerre-ci. » À la deuxième question classique du président qui n’avait auparavant jamais manqué d’embarrasser le réclamant : « Dites-moi, M. Strachey, que feriez-vous si vous voyiez un soldat allemand en train d’essayer de violer votre sœur ? » Il répondit avec un air fort vertueux : « Je tenterais de me mettre entre eux. »
En 1916, je rencontrai plus d’écrivains célèbres que je n’en avais alors et que je n’en ai depuis jamais rencontré. Deux de ces rencontres furent infructueuses. George Moore venait d’écrire The Brook Kerith et mes crispations de neurasthénique interrompaient le flot calme et naturel des périodes qu’il faisait en parlant. Il me demanda sur un ton irrité de ne pas remuer continuellement ; je lui fis en retour remarquer avec mépris qu’il avait introduit le cactus en Terre sainte quelque quinze siècles avant la découverte de l’Amérique, son pays d’origine.
Au Reform Club, H. G. Wells, qui n’était encore que « M. Britling » et qui brûlait d’enthousiasme militaire, parlait sans écouter les autres. Il venait de faire un « circuit Cook » en France et les accompagnateurs de l’état-major des guides de Cook lui avaient montré les lieux que les hôtes royaux, les hommes de lettres en vue et les personnalités neutres influentes avaient le droit de voir. Il s’étendit longuement sur son voyage et parut ne pas se rendre compte que Siegfried, que j’avais à mes côtés et moi-même avions, nous aussi, visité ces lieux.
Pères bénédictins français exilés en Angleterre
Je me liai d’amitié avec les pères bénédictins français qui vivaient non loin de là. Chassés de Solesmes par les lois anticléricales de 1906, ils s’étaient construit une nouvelle abbaye à Quarr. L’abbaye avait été tout spécialement chargée par le Vatican de retrouver et d’éditer des partitions de musique d’église. D’entendre les pères chanter des pièces de plain-chant me fit un instant complètement oublier la guerre. Nombre d’entre eux étaient d’anciens officiers de l’armée qui, m’apprit-on, s’étaient tournés vers la religion après avoir connu la violence des combats ou la douleur du chagrin d’amour. Ils considéraient la guerre comme un arrêt de Dieu tendant à rendre la France au catholicisme et me disaient que l’élément franc-maçon de l’armée française, représenté par le « Papa » Joffre avait été maintenant discrédité. et que l’actuel commandement suprême du général Foch était à prédominance catholique – présage, prétendaient-ils, de la victoire alliée.
L’hôtelier me montra une bibliothèque de vingt mille volumes dont des centaines étaient écrits en caractères gothiques. Le bibliothécaire, vieux moine originaire de Béthune, me pria de lui faire un compte rendu exact des dégâts que son quartier avait subis. L’hôtelier me demanda s’il me plairait de lire un de ces livres. Il y en avait de toutes sortes : histoire, botanique, musique, architecture, mécanique, presque toutes les activités laïques étaient représentées. Je lui demandai s’il s’y trouvait un rayon poésie. Il sourit avec douceur et me répondit que non, l’on ne pouvait pas considérer la poésie comme une lecture édifiante.
Siegfried met la crosse en l’air
« L’ironie de devoir démontrer à ces vieillards déments que Siegfried n’était pas sain d’esprit ! »
Peu de temps après, de durs combats éclatèrent sur la ligne Hindenburg. La section de Siegfried se porta au secours des Caméroniens et lorsque ces derniers furent chassés de quelques unes des tranchées qu’ils avaient enlevées, Siegfried reprit l’objectif à la tête d’un détachement de six hommes armés de grenades. Il avait eu la gorge traversée par une balle, ce qui ne l’avait pas empêché de continuer à lancer des grenades jusqu’au moment où il s’était effondré. Les Caméroniens rallièrent leur unité et revinrent, et le général de brigade inscrivit le nom de Siegfried sur la liste de ceux qui devaient recevoir la Victoria Cross – cette recommandation fut cependant rejetée sous prétexte que l’opération avait échoué. Plus tard, les Caméroniens avaient en effet été à nouveau repoussés par un détachement de grenadiers allemands commandé par un certain Siegfried.
De retour à Londres maintenant et très malade, il m’écrivait que souvent lorsqu’il se promenait, il voyait des cadavres gisant sur les trottoirs. En avril, Yates lui avait envoyé un mot pour lui dire que quatre officiers avaient été tués et sept hommes blessés au cours d’un engagement à Fontaine-les-Croiselles qui avait été « une belle boucherie ». Mais le bataillon avait progressé de presque sept cents mètres, ce qui, aux yeux de Siegfried, semblait une bonne consolation. Et pourtant il me disait dans la phrase suivante toute la fureur qu’il éprouvait en pensant aux innombrables braves qui avaient été massacrés cet été-là et en comprenant que tous ces sacrifices n’avaient servi à rien. Avec leurs satanés cafouillages d’incapables et leurs idées de brutes, ces crétins de politiciens et autres généraux feraient durer la plaisanterie jusqu’à s’en lasser ou jusqu’à ce qu’elle leur eût rapporté tous les honneurs qu’ils convoitaient. Il aurait bien voulu protester de quelque façon ; abattre même le Premier ministre ou Sir Douglas Haig ne changerait pas grand-chose puisque l’on se contenterait de l’interner dans une maison de fous, comme Richard Dadd de glorieuse mémoire. (Je reconnus l’allusion : brillant peintre du XIXe siècle, Dadd, qui était soit dit en passant un des grands-oncles d’Edmund et de Julian, avait dressé une liste de personnes qui méritaient la mort. Le premier de la liste était son propre père. Dadd le ramassa un jour dans Hyde Park et le porta sur ses épaules sur près d’un demi-mille avant de le noyer publiquement dans la Serpentine.) Siegfried poursuivait en disant que si en signe de protestation, il refusait de partir à nouveau, on l’accuserait tout simplement d’avoir peur du canon. Il me demandait si je croyais qu’à la fin de cet été de carnage notre situation se serait améliorée de quelque façon que ce fût. « Jamais nous ne réussirions à percer le front allemand avec des opérations de harcèlement. Jusque-là, nos pertes étaient plus lourdes que celles de l’ennemi. » À Vimy, les Canadiens avaient été effroyablement malmenés : les communiqués officiels n’en avaient pas moins menti de façon éhontée sur le chiffre des morts et des blessés. Julian Dadd lui avait rendu visite à l’hôpital et, comme tout le monde, l’avait pressé de prendre un travail tranquille en Angleterre mais il savait que cela ne serait jamais qu’un beau rêve : qu’il se sentirait moralement contraint de continuer la guerre jusqu’au moment où il se ferait tuer. L’idée de repartir sur le front était un supplice maintenant qu’il venait de retrouver la lumière – « Oh, la vie ! Oh le soleil !» (C’était une citation d’un de mes poèmes où je parlais du retour d’outre-tombe.) Sa blessure était pratiquement cicatrisée et il s’attendait à ce qu’on l’envoyât passer trois semaines dans une clinique de convalescence. La perspective ne lui souriait pas, mais là ou ailleurs il s’en contenterait pourvu qu’il eût la chance d’avoir le calme, qu’il ne vît personne et pût passer son temps à regarder les arbres se parer de vert et à se sentir pareil à eux. Il était « salement » affaibli et se trouvait dans un triste état nerveux. Il y avait dans la salle de l’hôpital un gramophone qui l’assommait au-delà de toute expression. Au bout du compte, l’Old Huntsman avait été publié au printemps et il allait, en guise de plaisanterie, en envoyer un exemplaire à Sir Douglas Haig. Personne ne pourrait de toute façon l’empêcher de faire ça.
Dans le courant du mois de juin, il avait été voir les Morrell à Oxford sans savoir que j’étais toujours là ; il ajoutait qu’il valait peut-être mieux que nous ne nous fussions pas rencontrés, car nous n’étions ni l’un ni l’autre en forme – il convenait que l’un d’entre nous au moins fût dans de saines dispositions lorsque nous passions un moment ensemble. Cinq de ses poèmes avaient paru dans le Cambridge Magazine (un des rares journaux agressivement pacifistes qui fussent à 1’époque publiés en Angleterre – ses bureaux devaient plus tard être mis à sac par les cadets du Flying Corps). Aucun d’entre eux, reconnaissait-il, ne valait grand chose, sauf en tant que coup de patte décoché contre toutes ces personnes satisfaites et parfaitement inqualifiables qui pensaient que la guerre devait se poursuivre indéfiniment, jusqu’à ce que tout le monde y eût laissé la peau, elles exceptées. Les pacifistes le suppliaient d’écrire quelque chose de violent à la manière du Feu de Barbusse, mais il n’y arrivait pas. Il avait d’autres choses en tête et pas des poèmes. (Je ne compris pas ce qu’il entendait par là, mais espérai qu’il ne s’agissait pas d’un programme d’assassinats à la Richard Dadd.) À l’idée de ce qui se déroulait en France, il perdait parfois la boule. Au beau milieu du Kent, il pouvait entendre le bruit sourd et incessant des canons tonnant de l’autre côté de la Manche. Ce grondement le hantait à tel point qu’il ne savait plus s’il voulait rejoindre précipitamment le Premier Bataillon et mourir avec lui, ou rester en Angleterre et faire tout ce qu’il pourrait pour empêcher que la guerre ne se prolongeât. Ces deux projets étaient aussi désespérés l’un que l’autre. Repartir pour se faire tuer ne serait qu’une manière d’épater la galerie – la mauvaise – et il ne voyait aucun moyen en métropole de s’opposer utilement à la guerre. On lui avait proposé un poste dans un bataillon de cadets stationné en Angleterre, ce qui s’il en voulait le mettrait à l’abri du danger ; mais il lui semblait que c’était là une honteuse échappatoire.
À la fin de juillet, une autre lettre de Siegfried me parvint à Osborne. Elle semblait plutôt mince. Pour la lire, je m’assis sur le banc que la reine Victoria avait dédié à John Brown (« Jamais cœur plus pur et plus fidèle n’a brûlé dans une poitrine humaine »). Tandis que je décachetai l’enveloppe, une coupure de journal portant à l’encre l’inscription Bradford Pioneer, vendredi 27 juin 1917 s’en échappa doucement. Je lus d’abord le mauvais côté :
IL FAUT LIBÉRER LES O.D.C.
par Philip Frankford .
L’objecteur de conscience est un homme courageux. Lorsque demain l’historien impartial résumera l’histoire de cette guerre terrifiante, il se souviendra de lui comme de l’une des rares figures nobles de cette tragédie mondiale.
L’O.d.C. s’oppose au militarisme. Il se bat pour l’indépendance et la liberté. Il s’attaque vigoureusement au despotisme. Et par-dessus tout, il ouvre la voie qui conduira à l’abolition définitive de la guerre.
Mais grâce à une presse mensongère, corrompue et dirigée par de sales capitalistes, de tels faits ne sont pas connus du grand public auquel on a appris à mépriser les objecteurs de conscience et à ne voir en eux que des chenapans, des couards et des tire-au-flanc.
Dernièrement les persécutions dont les O.d.C. sont l’objet ont repris. En dépit des promesses faites par de « fidèles » ministres du Cabinet, plusieurs O.d.C. ont été envoyés en France et arrivés là, condamnés à mort – sentence commuée plus tard en « crucifixion » ou en cinq ou dix ans de travaux forcés. Mais nous devons dire que même lorsqu’on leur donne la permission de rester dans ce pays, ces hommes – le sel de la terre – sont traités de façon scandaleuse. Des personnes aussi saintes que Clifford Allen, Scott Duckers et des milliers d’autres dont l’enthousiasme à défendre la cause de l’antimilitarisme n’est pas moins splendide, sont en prison pour une raison qui n’est autre que leur refus de prendre la vie humaine ; et parce qu’ils veulent ne pas renoncer à leur virilité en devenant les esclaves de la machine militaire. Ces hommes DOIVENT ÊTRE LIBÉRÉS.
Les « saboteurs » politiques en Irlande . . .
Alors je tournai la page et poursuivis ma lecture :
QU’ON EN FINISSE AVEC LA GUERRE
Déclaration d’un soldat.
(Ces propos furent tenus à son officier commandant par le sous-lieutenant au Troisième Bataillon du Royal Welch Fusiliers S. L. Sassoon, croix de guerre, recommandé pour la D. S. O., qui lui expliquait les raisons de son refus de servir plus longtemps dans l’armée. Il s’était engagé le 3 août 1914. Il fit preuve d’une remarquable bravoure en France, fut gravement blessé et aurait été versé dans les forces métropolitaines s’il n’avait pas quitté l’armée.)
« La présente déclaration est un acte de défi délibéré à l’autorité militaire. Je la fais parce que je crois que la guerre est prolongée à dessein par ceux qui ont le pouvoir d’y mettre fin. Je suis soldat et suis convaincu que j’agis au nom des soldats. Je crois que cette guerre à laquelle j’avais décidé de prendre part à cause de son caractère de guerre de défense et de libération est devenue aujourd’hui une guerre d’agression et de conquête. Je crois que les buts pour lesquels mes camarades-soldats et moi-même avions décidé de participer à cette guerre auraient dû être assez clairement définis pour qu’il fût ensuite impossible de les modifier et je pense que s’il en avait été ainsi, nous pourrions maintenant atteindre par voie de négociation les objectifs qui nous avaient incités à agir comme nous l’avions fait alors.
« J’ai vu et j’ai supporté les souffrances des troupes et je ne puis plus longtemps être complice de la prolongation de telles souffrances à des fins que je crois mauvaises et injustes .
« Je ne m’élève pas contre la façon dont la guerre est menée mais contre les erreurs politiques et les mensonges pour lesquels on sacrifie les combattants.
« Au nom de ceux qui souffrent aujourd’hui, j’élève cette protestation contre la duperie dont ils sont victimes. Et je crois aussi que je puis peut-être aider ainsi à la destruction de la suffisance brutale avec laquelle la majorité de ceux qui sont en Angleterre envisagent la prolongation de martyres qu’ils ne partagent pas et qu’ils n’ont pas assez d’imagination pour comprendre.
Juillet 1917.
S. SASSOON.
Tout cela me plongea dans l’inquiétude et le malheur. J’étais tout à fait d’accord avec Siegfried sur « les erreurs politiques et les mensonges » et trouvai qu’il avait agi avec un courage magnifique. Mais il convenait de voir plus loin que la justesse de la cause que nous défendions contre les politiciens. D’abord, Siegfried était du point de vue physique absolument incapable de supporter la peine que sa lettre appelait : c’est-à-dire de passer en conseil de guerre, d’être dégradé et emprisonné. J’en voulais amèrement aux pacifistes de l’avoir encouragé à accomplir un tel acte. Je sentais que n’étant pas soldats eux-mêmes, ils ne pouvaient pas comprendre ce qu’il en coûtait à l’émotivité de Siegfried. Il était abominable qu’il eût à faire face aux conséquences de sa lettre après en être passé par les épreuves du Quadrilatère et de Fontaine-les-Croiselles. Je mesurais aussi l’absurdité d’un tel geste. Personne ne suivrait son exemple, que ce fût en Angleterre ou en Allemagne. Cela n’empêcherait pas la guerre de se poursuivre jusqu’à l’effondrement total de l’un des deux adversaires en présence.
Je demandai aussitôt à comparaître devant la commission médicale qui devait siéger le lendemain et priai les docteurs de me déclarer apte au service en métropole. Je ne l’étais pas, ils le savaient bien, mais je le leur demandai comme un service. Il me fallait quitter Osborne et m’occuper de cette affaire Siegfried. j’écrivis ensuite à l’Honorable Evan Morgan avec qui j’avais, un ou deux mois auparavant, fait du canoë à Oxford et qui était le secrétaire particulier d’un des ministres du gouvernement de coalition. Je lui demandai de faire tout son possible pour empêcher qu’on ne réédite la lettre ou qu’on la commente et de faire en sorte qu’une réponse satisfaisante fût faite à M. Lees Smith, le principal député pacifiste au Parlement, lorsqu’il interpellerait la Chambre à ce sujet. J’expliquai à Evan que j’étais en fait du côté de Siegfried, mais que l’on ne devait pas lui permettre de devenir le martyr d’une cause désespérée dans l’état actuel de ses forces. J’écrivis enfin au Troisième Bataillon. Je savais que le colonel Jones-Williams avait un sens étroit du patriotisme, qu’il n ‘avait jamais été en France et que l’on ne pouvait attendre de lui qu’il se montrât compréhensif. Mais le commandant en second, le major Macartney-Filgate, était humain. Je le suppliai donc d’amener le colonel à voir la chose sous un jour raisonnable. Je lui parlai des épreuves que Siegfried avait récemment traversées sur le front et lui suggérai qu’on le fit passer devant une commission médicale et qu’on le réformât définitivement.
C’est alors que Siegfried m’écrivit de l’Exchange Hotel à Liverpool pour me dire que je devais sans doute me faire du souci pour lui. Il était monté à Liverpool un jour ou deux auparavant et s’était présenté à la salle de rapport du Troisième Bataillon. Il s’était senti très mal à l’aise, mais il avait dû paraître à peu près maître de lui. Le major Macartney-Filgate qu’il avait trouvé au poste de commandement en l’absence du colonel avait été d’une inimaginable gentillesse (à tel point qu’il s’était fait l’effet d’une vraie brute) et avait demandé l’avis du général qui commandait les forces de défense de la Mersey. Pour l’heure, ce général devait « être en consultation avec Dieu le Père ou quelque chose d’approchant ». En attendant, je pouvais lui écrire à l’hôtel : il promettait de ne pas s’enfuir au Caucase. Il espérait arriver en temps utile à les amener à être sévères – ils ne se rendaient pas compte, sans doute, que son exploit serait bientôt magnifiquement orchestré par la presse. Bien qu’il exécrât plus que jamais toute l’affaire, il savait aussi plus que jamais qu’il avait raison et que jamais il ne se repentirait de ce qu’il avait fait. Il ajoutait que la situation semblait meilleure en Allemagne, mais que Lloyd George n’y verrait sans doute qu’un autre « complot ». Il lui apparaissait que les hommes politiques étaient incapables de se comporter comme des êtres humains.
Le général ne consulta pas Dieu le Père mais le ministère de la Guerre. Et le ministre Evan persuada le ministère de la Guerre de ne pas en faire un cas passible de punition disciplinaire, mais de convoquer Siegfried devant une commission de médecins. Evan s’était bien acquitté de sa mission. Je me proposai ensuite de faire en sorte que Siegfried passât devant un conseil de réforme. Je ralliai le bataillon et le rencontrai à Liverpool. Il paraissait très malade. Il me raconta qu’il venait d’aller au club de golf de Formby et de jeter sa croix de guerre à la mer. Nous parlâmes de la situation politique . Je soutins l’idée qu’avec quelques autres, nous étions les seuls à échapper à la folie générale et que nous ne ferions que nous attirer des ennuis en parlant raison à des détraqués. Il ne nous restait qu’une seule issue : continuer jusqu’au moment où nous nous ferions tuer. En ce qui me concernait, je m’attendais à repartir au front, pour la quatrième fois. De plus, que penserait-on de lui au Premier et au Deuxième bataillons ? Comment pouvait-on espérer d’eux qu’ils comprissent son point de vue ? On l’accuserait de tourner casaque, d’avoir la trouille et de laisser tomber le régiment. Comment le vieux Joe même, lui qui était l’homme le plus ouvert du régiment, comprendrait-il son acte ? À qui la lettre s’adressait-elle ? L’armée n’y pourrait jamais voir, lui répétai-je, qu’une déclaration de poltron ou au mieux, qu’un manquement aux règles du savoir-vivre. Quant aux civils, leur attitude serait encore plus sévère, surtout lorsqu’ils découvriraient que S est l’initiale de « Siegfried ». Il refusa de me donner raison, mais je lui laissai clairement entendre que sa lettre n’avait pas été et ne serait pas l’objet de l’orchestration publicitaire qu’il attendait. Ne pouvant au moins nier la gravité de sa maladie, Siegfried consentit à se présenter devant la commission médicale.
Autant de gagné ! Il me fallait ensuite influencer ladite commission. Je sollicitai la permission de témoigner en ma qualité d’ami du malade. La commission comptait trois docteurs, un colonel et un général du R.A.M.C. et un capitaine « jusqu’au boutiste ». J e compris bien vite que le colonel était patriotard et mal disposé ; le général raisonnable mais dépassé par les événements ; et le capitaine, spécialiste compétent des maladies nerveuses, sain d’esprit : il serait donc mon seul espoir. Je dus une fois encore raconter toute l’histoire en traitant le colonel et le général avec la plus grande déférence, mais en usant du capitaine comme d’un allié pour entamer leurs réticences. Je dus, bien à contrecœur, jouer le rôle du patriote affligé par le collapsus mental de son compagnon d’armes – effondrement dont la cause n’était autre que les magnifiques exploits qu’il avait accomplis dans les tranchées. Je mentionnai les « hallucinations » de cadavres jonchant Piccadilly dont Siegfried était victime. L’ironie de devoir démontrer à ces vieillards déments que Siegfried n’était pas sain d’esprit ! Je comprenais parfaitement que je trahissais la vérité, mais je n’en continuai pas moins de tenir mon rôle de jésuite.
J’étais nerveusement dans un état voisin de celui de Siegfried et par trois fois, j’éclatai en sanglots au milieu de ma déposition. Le capitaine Mc Dowell, qui devait devenir dans Harley Street un psychologue de renom, entra bien dans mon jeu. « Jeune homme, me dit-il alors que je quittai la salle, c’est vous gui devriez passer devant cette commission. » Je priai le ciel qu’en entrant dans la salle après mon départ, Siegfried n’anéantît point mon œuvre en ayant l’air trop sain d’esprit. Heureusement Mc Dowell convertit ses supérieurs à mon point de vue.
Macartney-Filgate me confia la tâche d’escorter Siegfried jusqu’à une maison de repos pour neurasthéniques située à Craiglockhart, près d’Édimbourg. Siegfried et moi trouvâmes tous deux l’affaire fort plaisante surtout lorsque après que j’eus manqué le train, il se présenta sans moi à « Dingoville » comme il disait. À Craiglockhart, Siegfried fut placé sous la surveillance du professeur W. H. R. Rivers, que nous rencontrions pour la première fois bien que nous eussions déjà entendu parler de lui comme de l’un des neurologues, ethnologues et psychologues les plus éminents de Cambridge. Il s’était fait un devoir d’ouvrir un nouveau département de recherches toutes les quelques années et de l’incorporer dans son vaste plan d’études anthropologiques.
Rivers mourut peu de temps après la guerre, au moment où il était sur le point de se porter candidat libre du Labour au siège de l’université de Londres au Parlement ; il avait l’intention de clore son cycle d’études par des travaux sur la vie politique. Il s’était pour l’instant lancé à fond dans la psychologie des états morbides. L’on avait commis à sa garde plus de cent cas de neurasthénie : il diagnostiquait l’origine du mal en ayant en grande partie recours à une étude de leur vie onirique fondée sur les travaux de Freud bien qu’il répudiât hautement ses thèses plus idiosyncratigues. Son œuvre posthume Les Conflits et le rêve est le résultat de ces travaux de Craiglockhart. […]
Siegfried et Rivers devinrent bientôt amis intimes : Siegfried s’intéressait aux méthodes qu ‘utilisait Rivers pour établir ses diagnostics et, de son côté, Rivers s’intéressait aux poèmes de Siegfried. En repartant d’Édimbourg, je me sentis le cœur plus léger.
Siegfried commença la composition de la terrifiante série de poèmes dont quelques-uns furent inscrits au sommaire du magazine de l’hôpital de Craiglockhart, The Hydra, et qui furent un an plus tard publiés sous le titre de Contre-Attaque.
Armistice
En novembre ce fut l’Armistice. Au même moment, j’appris la mort de Frank Jones-Bateman qui était reparti pour le front peu avant la fin des combats et celle de Wilfred Owen qui m’envoyait souvent des poèmes de France. L’hystérie qui éclata le soir de l’Armistice ne toucha guère notre camp, malgré la présence de quelques Canadiens qui descendirent à Rhyl fêter la chose dans le plus pur style d’Outre-Atlantique. En apprenant la nouvelle, je m’en fus me promener sur la digue qui domine les marais de Rhuddlan (ancien champ de bataille, celui du Flodden of Wales) où je ne cessai de maudire le sort, de sangloter et de penser aux disparus.
Le célèbre poème de Siegfried à la gloire de 1’Armistice commençait ainsi :
Et soudain tout le monde partit à chanter,
Et mon cœur s’emplit de la joie
Qu’éprouve l’oiseau captif libéré …
Mais je ne fis point partie de ce « tout le monde ».
Mutineries
Quelques semaines plus tard, j’assistai à une mutinerie des Guards : à cette occasion quelque mille soldats appartenant à tous les régiments possibles sortirent du camp de Shoreham et défilèrent dans les rues de Brighton pour protester contre d’inutiles contraintes. Que les troupes n’eussent pas supporté la discipline militaire entre l’Armistice et la signature de la paix ravissait Siegfried ; il avait pris une part active à l’élection générale que Lloyd George imposa immédiatement après !’Armistice et où il demanda les pleins pouvoirs pour pendre le Kaiser et dicter une paix sévère. Siegfried avait soutenu la candidature de Philip Snowden qui défendait un programme pacifiste et avait fait face à une foule menaçante de civils ; il croyait que ses trois chevrons de blessé, le ruban mauve et blanc de la Military Cross (qu’il n’avait pas jeté avec la médaille) lui gagneraient une audience privilégiée. Snowden et Ramsay Mac Donald étaient peut-être les deux hommes les plus impopulaires de l’Angleterre, et. quels qu’aient pu être les espoirs que nous avions nourris d’un soulèvement général des anciens combattants contre le gouvernement, ils disparurent bien vite.
De retour en Angleterre les anciens combattants se contentèrent d’avoir un toit sur la tête, de manger de la nourriture de civil, de boire une bière qui au moins était meilleure que la bière française et d’avoir assez de couvertures pour la nuit. Qu’ils fussent à l’étroit chez eux ne pouvait se comparer avec ce à quoi ils avaient dû se faire : en France une masure abandonnée de quatre pièces servait de logement à soixante hommes. Ils avaient gagné la guerre, cela leur suffisait : pour le reste, ils s’en remettaient à Lloyd George.
La seule révolte sérieuse eut lieu à Rhyl. Là une mutinerie de jeunes Canadiens qui dura deux jours causa beaucoup de destructions et entraîna plusieurs décès. Le signal du soulèvement fut ce cri : « Allez ! les bolcheviques ! »
URL de cet article : http://blog.lesgrossesorchadeslesamplesthalameges.fr/index.php/adieu-a-tout-cela/
11 novembre 2021
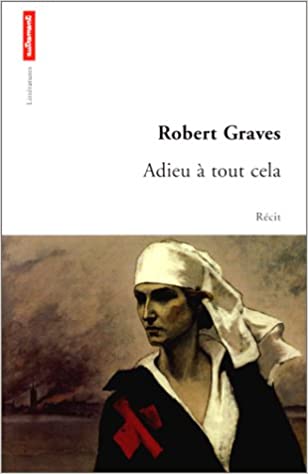
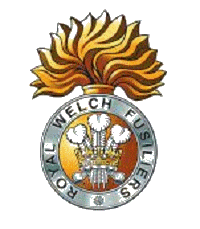





0 Comments