Outre un auteur de thrillers honoré de plusieurs prix internationaux, Michael DIBDIN est le plus italien des écrivains britanniques. Avec ses onze titres consacrés au sous-commissaire (vice questore) Aurelio Zen, se déroulant chacun dans une ville ou une région différente du pays, il a brossé un tableau de l’Italie des années de plomb que ne pourront pas ignorer les historiens futurs. Il y a parlé des Italiens comme quelqu’un qui non seulement les connaissait très bien – il a enseigné des années à Pérouse – mais qui les aimait. Et comme quelqu’un qui a été capable de comprendre, en profondeur, tout ce qui agitait la péninsule, des affrontements du passé jamais cicatrisés aux aspirations et aux déchirements du présent, sur fond d’interventions étrangères de tous ordres. L’Italie de cette époque mouvementée a trouvé en lui son nouveau Stendhal. Michael DIBDIN a fini sa vie à Seattle (USA) en 2007.
Pour les curieux, nous avons griffonné un rapide résumé de ces deux livres :
Ces deux volumes sont apparemment aux antipodes l’un de l’autre, avec, pour pivot et point commun, le vice-questore Aurelio Zen, natif de Venise et attaché, à Rome, au ministère de l’Intérieur.
Zen est un homme calme, observateur, intègre, très doué pour le métier qu’il fait, mais ne récoltant jamais de ce qu’il accomplit que des déboires, parce qu’il croit en l’honnêteté et en la justice et que ses supérieurs hiérarchiques, en revanche, n’en ont que faire. Sa réussite sociale est nulle, et il n’en finit pas d’être déplacé d’un endroit du pays dans l’autre pour satisfaire des autorités locales qu’il dérange en résolvant brillamment ses enquêtes.
Né à Venise avant la guerre, il a vu partir son père pour le front russe et n’en pas revenir. Sa mère l’a élevé, en faisant des ménages, dans la vénération de l’héroïque disparu.
Il est marié et séparé de son épouse depuis quinze ans, le mariage à l’italienne n’incluant pas le divorce, et, au moment où débute Lagune morte, l’Américaine qui partageait sa vie est rentrée dans son pays avec un compatriote avocat et il essaie de cohabiter avec une collègue de son ministère sans provoquer de drame maternel. C’est alors que son « ex » l’appelle en pleine nuit de New York, pour le prier de rendre service à des clients du nouvel homme de sa vie, famille extrêmement riche dont le chef a disparu à Venise dans des circonstances mystérieuses. S’il arrive à le retrouver, mort ou vif, sa fortune sera faite parce que celle du disparu ne sera plus sous séquestre pour cause d’enquête à l’infini. Ces honoraires pharamineux seraient les très bienvenus pour loger décemment la nouvelle élue ailleurs que chez mamma.
Zen se fait adjuger une enquête vénitienne théoriquement de tout repos pour camoufler l’autre et renoue, après beaucoup d’années, avec sa ville natale. Ce qu’il y trouve est plus noir que noir : corruption politique et policière, démagogie fascisante, manœuvres maffieuses, gangs de la drogue terriblement inventifs en matière d’assassinats, et ville pourrissant à grande vitesse du tourisme en même temps qu’elle en vit.
Il serait impie de déflorer une intrigue aussi profondément sombre que brillamment résolue, à la fin de laquelle Zen se retrouve trahi par la concitoyenne qu’il envisageait d’épouser et.. même plus orphelin d’un père déserteur qui a refait sa vie en Pologne et vient d’accompagner sa nouvelle famille venue voir son pape. Pour couronner le tout, le coupable qu’il a démasqué devient maire de Venise et obtient de ses supérieurs qu’il soit mis sur la touche, n’importe où, le plus loin possible. Pas de problème.
C’est ainsi que dans le roman suivant, Cosi fan tutti, Zen se retrouve à Naples, sur une voie de garage de la police douanière, où il pourra s’escrimer tant qu’il voudra entre Camorra, terroristes et habitudes napolitaines multiséculaires.
Il a parfaitement compris et, bien décidé à ne plus se laisser entraîner à faire scrupuleusement son métier, prévient d’emblée ses inférieurs, qu’ils devront faire comme s’il n’était pas là et que, d’ailleurs, il ne sera « là » que le moins possible, ce qui a pour résultat d’en faire leur idole. De son adjoint au dernier des plantons, c’est à peine s’ils ne baisent pas la trace de ses pas. On lui demande néanmoins de bien vouloir rendre service à une grande – et riche – bourgeoise du coin, dont les deux ravissantes filles se sont amourachées de deux jeunes (hélas beaux) malfrats dont ne veut pas leur mère. Zen se dit qu’il ne risque rien à donner un petit coup de main, se débrouille pour faire envoyer les deux donzelles à Londres au prétexte d’y étudier quelque chose, recrute sur le port deux réfugiées albanaises du genre bombes sexuelles et les lance dans les pattes des deux soupirants transis.
On aura reconnu sans peine l’intrigue de Cosi fan tutte, dont Cosi fan tutti est un étourdissant pastiche, au point que tous les intitulés de chapitres sont de Da Ponte. Rien n’y est sérieux, on y rit tout le temps, et après que les réfugiées albanaises se soient avérées des travestis napolitains et les deux malfrats des étoiles montantes de la brigade antiterroriste, la marmite n’explose pas et l’histoire finit bien pour tout le monde.
Comme l’auront deviné ceux qui ont eu la curiosité de lire nos 5e de couvertures, le premier des deux livres est aussi sombre et désespéré que l’autre est irrésistiblement drôle et allègre, avec le même Zen pour personnage principal.. On peut ne pas s’en apercevoir, si on ne les lit pas à la suite l’un de l’autre, bien qu’ils se suivent très intentionnellement dans le canon de l’auteur.
L’explication en est donnée à la fin de Cosi fan tutti, quand Aurelio Zen déclare, à toute la troupe rassemblée pour le finale :
— Un célèbre philosophe a remarqué un jour que tout arrive deux fois. Un philosophe ultérieur – encore plus célèbre dans ma jeunesse, mais maintenant presque oublié – a remarqué que son prédécesseur aurait dû ajouter « que la première fois, c’était une forme de tragédie, et la deuxième fois une farce ».
ajoutant :
— Je ne suis pas philosophe, mais mes expériences récentes m’ont convaincu que cela correspond à ma propre vie. Et, si l’on peut me permettre d’ajouter ma modeste note en la matière, il vaut mieux que ce ne soit pas le contraire.
Le premier philosophe pourrait bien être Hegel, mais le second est assurément Karl Marx, qui a fait cette remarque à propos des deux empereurs Napoléon de la France.
Presque oublié lui aussi est aujourd’hui Michael Dibdin, dont les éditeurs français n’ont même pas attendu la mort pour le laisser tomber. Ses trois derniers romans – dont Back to Bologna, un bijou plein de pépites – n’ont jamais été traduits.
Espérons que l’ingrate indifférence de nos cieux incléments tant pour l’auteur que pour le philosophe ne sera que temporaire et que l’illettrisme venu d’en-haut qui nous accable sera à son tour oublié le plus tôt possible.
Bon anniversaire, camarade !
URL de cet article : http://blog.lesgrossesorchadeslesamplesthalameges.fr/index.php/autres-livres/
5 mai 2020

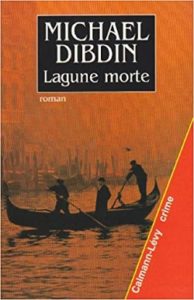

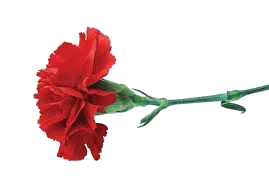
0 Comments